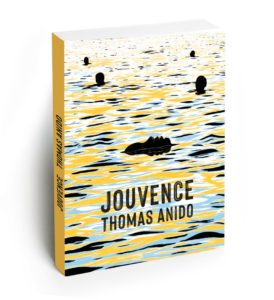Chaque année, quand je commence à regarder le Tour de France, à grappiller par-ci par-là le temps de voir quelques bouts d’étapes de montagne, je n’imagine pas une seconde que les cyclistes sont dopés. Je ne regarde pas le Tour dans cet esprit ; je l’approche avec toute la naïveté de l’amateur inconditionnel (ou du moins veuillé-je bien le croire). Ce qui me plaît, c’est la lutte dantesque pour l’étape et le chrono — lutte physique et tactique, à la fois individuelle et collective, où souvent même l’on pactise temporairement avec l’adversaire, ce qui donne notamment la configuration habituelle de l’inséparable duo en duel pour la tête du classement.
Inévitablement pourtant — est-ce ainsi chaque année ? —, plus ou moins tard dans la course se produit un tournant dramatique, un coup de force improbable, et les réseaux bruissent toujours à nouveau du même soupçon (pas de ça en revanche chez les commentateurs télé, pas question de cracher dans la soupe, pas avant en tout cas que la justice n’ait soulevé quelque lièvre, et Jalabert moins encore que les autres, qui traîne au cul de son biclou de vieilles casseroles d’EPO). Cette accusation, serait-elle au fond un vieux poncif parmi d’autres du commentaire automatique, qui recycle en boucle son stock d’opinions toutes faites, de celles qu’on débite avec gourmandise entre initiés comme supplément d’agrément à la consommation du spectacle ?
Et n’est-ce pas encore ainsi chaque année : l’inséparable duo-en-duel au-dessus du lot (Van Aert, troisième lors du contre-la-montre du 18 juillet, n’a-t-il pas déclaré qu’il était « le premier des gens normal ? » — sic), composé d’un favori imbattable, cadenassant la course à l’aide d’increvables lieutenants, et d’un challenger intrépide et pugnace, qui revient chaque jour à la charge mais n’a pas la moindre chance, à qui le premier laisse pourtant un temps croire qu’il pourra venir le titiller, lui mordiller les mollets — à cet hameçon d’ailleurs le public aussi mord. Ou du moins veut-il bien y mordre. Mais à la fin, rien à faire : c’est toujours le favori qui gagne, et l’autre qui défaille. Ironie du sort : Pogacar redevient justement bien normal, beaucoup trop même, le lendemain du contre-la-montre, en s’effondrant dans la dernière ascension, infernale, la plus raide de toute l’édition, informant son équipe qu’il jette l’éponge — « I’m gone, I’m dead » l’entendra-t-on, en léger différé, lâcher dans la conversation radio — et perdant ensuite six minutes sur le rouleau débridé Vingergaard. Avait-il été privé de jus d’orange au p’tit déj’, demandent déjà les mauvaises langues ?
C’est une petite nouveauté de la cuvée 2023, dix-sept équipes ayant accepté qu’on retransmette après coup quelques-uns des mots qu’échangent entre eux dans le feu de l’action coureurs et directeurs sportifs. Dans ce cas précis, la parole ainsi jointe à l’image — Pogacar à bout de forces se laissant tout à coup distancer — renforce indéniablement la dimension tragique de l’instant, c’est bon pour le show ; mais quid des phrases que nous n’entendons pas, et des gestes que nous ne voyons pas ? Simulacre et fantasme d’une transparence absolue, dont on rend toujours plus avide le public qui ne rechignerait pas sans doute à s’immiscer jusque sous les draps de ses champions : on espère d’ailleurs peut-être ainsi nous convaincre, rien n’étant plus caché, qu’à la fontaine où ces derniers s’abreuvent coule une eau parfaitement claire…
(Et que cherche exactement le public, ce vampire, sinon à palper, dévorer, digérer ses idoles, quand il enserre la route au point d’étrangler le goulet par où celles-ci se faufilent tant bien que mal en danseuse — on dirait presque que le cycliste doit forer lui-même sa propre trouée, et la roue avant qu’il gouverne depuis son guidon fait alors office de tronçonneuse —, la foule soi-disant bon enfant s’agglomérant tel un redoutable intestin, à la fois colon et boa constricteur, une mer avare de ses miracles qui ne s’écarte devant vous que pour mieux vous engloutir. On a ainsi vu, entre autres incidents de course de toutes sortes impliquant parfois même motos et voitures calant dans des virages en épingle trop pentus, un spectateur faire chuter le champion de France en titre Valentin Madouas dans le col dit de la Grosse Pierre. Sur le ralenti, on voit deux bras projetés depuis la droite sur le passage du coureur qui, déséquilibré, se cabosse violemment ; excès d’enthousiasme peut-être, excès d’amour sans doute, mais qui vire au meurtre. Une image saisissante vient ensuite : tandis que le pauvre Madouas, dont on imagine les genoux et les coudes douloureusement écorchés, se relève tout déboussolé par la commotion, le coupable de son malheur semble se détourner de lui sur-le-champ, indifférent à son crime comme à sa victime, pressé déjà de voir arriver les suivants, surtout ne pas les rater — les tuer eux aussi donc ? —, et ses voisins de même, personne pour porter secours à Madouas. On l’a déjà oublié : pour lui c’est trop tard, perdu, raté. N’y pensons plus, puisque la faute à la foule c’est la faute à personne, ou c’est la faute aux risques du métier.)

(Et les coureurs, comment font-ils, au comble de l’intensité, pour supporter cette encombrante ferveur, pour ne pas succomber à la terreur parmi la bousculade qui menace à chaque instant de les renverser, sous la clameur qui doit leur déchirer les tympans — quand j’ai participé récemment, pour la première fois de ma vie, à une course à pied de dix kilomètres, je me suis trouvé comme sonné, abasourdi, affolé par le brouhaha continu des encouragements, pourtant inoffensifs et touchants même, que nous prodiguaient le long de certaines sections du parcours des habitants de tous âges du quartier — à moins que ce ne soit précisément pour cette raison même qu’ils s’acharnent à rouler, rouler, rouler toujours plus vite et plus loin, pour échapper à ce public anthropophage, mais après le public il y a encore du public ; c’est comme si à mesure même qu’ils le fuyaient, ils s’y enfonçaient toujours plus profondément, jusqu’à l’arrivée finale, seule délivrance possible, ou l’abandon, voire la mort, et le silence enfin.)
Sans doute le schéma du duo n’a-t-il pas été systématique, mes souvenirs sont flous mais il y a eu ce Tour par exemple où Julian Alaphilippe a porté un certain temps, contre toute attente, le maillot jaune, de même que Thomas Voeckler quelques années auparavant, tous deux forts certes mais notoirement outsiders, ô combien vulnérables dans la montagne, on tremblait pour eux dans chaque col, chacun, héroïque, repoussant au plus tard le moment d’être tout de même surclassé, inéluctablement, par quelque grimpeur supersonique. Comme quoi sont aussi survenues des surprises — néanmoins une chose est sûre : jamais elles ne vont au bout. Un Tour, ça se verrouille, c’est comme une loi mathématique : de si juteux enjeux ne sauraient être abandonnés aux faiblesses de la probité. Faussement dupe, le public feint par romantisme de croire aux chances du second — appelez-ça le syndrome Poulidor si vous voulez — il s’y attache comme à David contre Goliath, mais qu’il soit second, est-ce vraiment pour autant la garantie qu’il soit humain ? L’homme armé de ses seules jambes, ne doit-on pas le chercher plus bas dans le classement (et trouver peut-être aussi des Français, enfin, par la même occasion) ?
Last modified: 7 mars 2024