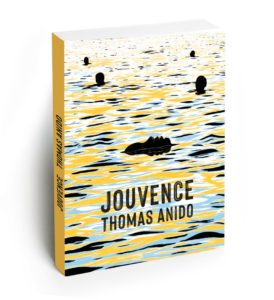Par la suite, glanant des interviews de Krasznahorkai, j’appris qu’il se disait très marqué par un livre de Timothy Morton (« Philosophe prophète de l’Anthropocène » selon The Guardian, et cité parmi les 50 penseurs les plus influents de 2020 par Prospect et Forbes, me dit Google Books) : La Pensée écologique. Confiant à tort en l’adage selon lequel les amis de mes amis sont mes amis, je l’empruntai donc à la médiathèque ; hélas, j’en fus pour mes frais, peu convaincu par cette philosophie typiquement post-moderne qui fourmille de références superficielles, faisant plus office d’alibis que de matière à dialectique, et masque mal, derrière des brumes sophistiquées, sa faible assise conceptuelle. Bien d’ailleurs qu’un nombre considérable de phrases, lassant à force, annonce répétitivement la délimitation du prédicat : « La pensée écologique, c’est… » (dans la traduction de Cécile Wajsbrot), on peine à saisir en quoi ladite pensée consiste exactement. Bien sûr, on voit bien que le philosophe prophète s’efforce d’abattre la frontière, rien d’autre qu’artificielle selon lui, entre nature et culture (et je vois bien aussi en quoi cela parle à Krasznahorkai, à qui je ne saurais tenir rigueur de cette affinité intellectuelle, tant son œuvre n’en continue pas moins de m’émerveiller), pourquoi pas, encore qu’une telle proposition mériterait d’être plus scrupuleusement explicitée, et peut difficilement se vanter, après Latour et Descola (nulle part cités, si mes souvenirs sont bons), d’être très novatrice. Alors oui, d’accord, la ville toute bitumée, bâtie à partir de matériaux extirpés de la terre par les animaux à gros cerveau que l’évolution a faits de nous, peut être considérée comme nature prolongée, quand bien même on n’y trouverait plus le moindre arbuste ni oiseau — et d’ailleurs, en réalité, on les y trouve encore, qui en outre s’y adaptent, n’est-ce donc pas la preuve du grand Tout inextricable ? On voit bien aussi qu’il cherche à miner la conception naïve selon laquelle il y aurait la gentille nature à préserver d’un côté, et la vilaine technique à réfréner de l’autre, car oui, d’accord, la nature est impitoyable par quelque bout qu’on la prenne, les tremblements de terre, les raz de marée, les éruptions volcaniques et les grizzlis c’est sans pitié (tout en fustigeant d’ailleurs cette forme de bien-pensance écologique qui fait preuve d’une indulgence immodérée envers une nature fantasmée, il ne s’interdit pourtant pas de glisser quelques discrets appels du pied en direction du camp progressiste, le seul auquel il conviendrait apparemment d’appartenir : voilà qui est bien consensuel pour qui croit écrire un décapant brûlot). On voit bien enfin qu’il prétend à une sorte de panthéisme transhumaniste où vivraient en parfaite symbiose les amibes et les cyborgs (ceux de de Donna Haraway), mettant toutes les espèces possibles dans le même sac et sur un pied d’égalité (en quoi il est pourtant contredit à mon avis par l’un des auteurs auquel il revient le plus souvent, Richard Dawkins qui, dans Le Gène égoïste, présente par analogie la culture humaine comme un processus évolutif émancipé de l’évolution génique, quoique émergeant de celle-ci) ; à cette fin il introduit la notion de « maillage » qui me paraît fort ressembler aux rhizomes de Deleuze et Guattari (pourtant le mot lui-même n’apparaît pas, bien que Deleuze soit incidemment cité une fois ou deux), et lui sert à réaffirmer que tout est dans tout, la Terre et ses soi-disant occupants et jusqu’à leurs terrifiantes technologies ne constituant en somme qu’un seul et même vibrant organisme, régi par des effets papillon en cascade. En conséquence, ou en prémisse je ne saurais dire, de quoi l’individu n’existe pas — nous voilà bien attrapés —, si ce n’est comme illusion à surmonter (on bâille un peu, on s’accroche, mais on ne saura jamais, nous pauvres mortels, comment la dépasser), assène-t-il un tantinet péremptoirement, s’autorisant cette fois des travaux du philosophe Derek Parfit, vers un article duquel il renvoie, dont je n’ai lu en ligne que la moitié car il est long comme un livre, mais qui m’a beaucoup amusé, puisqu’il s’agit d’une tortueuse tentative de démontrer, dans la plus tatillonne et scolastique tradition de la philosophie analytique, expériences de pensée aberrantes à l’appui (du type : s’il ne me reste qu’un hémisphère du cerveau, et qu’il est transplanté dans le crâne vide d’un autre organisme, cet autre organisme devient-il moi ?), que nous pourrions hypothétiquement nous affranchir du schème de personne, cette vieille idée selon laquelle, pour le dire vite, notre identité est déterminée, et qui a pour conséquence fâcheuse d’impliquer l’existence substantielle de quelque chose comme un ego, une âme ou une conscience…
Là réside d’ailleurs pour moi le principal problème du livre : d’amples et prudentes circonvolutions spéculatives que d’autres que lui ont menées, et qu’il ne mentionne qu’en passant, Morton se contente de déduire des effets de manche et des slogans performatifs.
« Faut la connaître la vieille p… Vous savez à qui je pense ? La Nature. Quand elle fait diversion ainsi sur un flanc par quelque chose d’inattendu, faut pas protester, faut pas opposer de la résistance, mais au contraire s’y plier, faire bonne mine… Mais intérieurement, ne pas lâcher, surtout ne pas perdre des yeux notre but, de façon qu’elle sache bien que nous poursuivons le nôtre propre. Pour commencer, elle est toujours très catégorique, tranchante, etc. dans ses interventions, mais après c’est comme si son intérêt soudain tombait, elle se relâche et alors on peut revenir en cachette à ses propres travaux en comptant même sur une certaine indulgence de sa part… »
Extrait de La Pornographie, de Witold Gombrowicz (Traduction Georges Lisowski)

Last modified: 18 novembre 2024