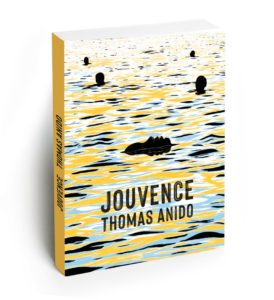Livres lus Tag Archive
Démolir Binet : la Conquista inversée
Quand on s’intéresse à l’histoire de la Conquista, et à la manière dont quelques poignées d’hommes ont fait tomber des empires peuplés d’habitants par millions, on ne peut s’empêcher de se demander : que se serait-il passé si Cortés n’avait pas défait Moctezuma, si Pizarro n’avait pas défait Atahualpa, comme ils y sont parvenus tous deux avec des tactiques sensiblement similaires, si l’on fait abstraction des contextes et phases d’approche en revanche bien différents, Pizarro s’étant longuement enlisé dans les mangroves de la côté pacifique de l’actuel Équateur, errant des années sans perspective concrète avant d’enfin trouver une ouverture prometteuse, en l’occurrence en direction de la ville andine de Cajamarca, tandis que Cortés a tracé sa route, semée d’embûches certes, à travers le Mexique avec d’emblée la certitude qu’il y avait là quelque part derrière quelque chose à prendre, même s’il ne savait pas encore quoi avant d’arriver à Mexico-Tenochtitlan. Tactiques similaires coïncidant, en gros, par une inconscience salutaire des forces réelles en présence, par un habile double jeu attisant les dissidences locales, et surtout par la spectaculaire prise en otage du souverain suprême qui a sonné le glas de chacun des deux empires. On ne peut s’empêcher d’imaginer que les choses auraient pu tourner différemment, parce que dans les deux cas il y eut au moins une occasion pour les autochtones de profiter du rapport de force démesurément à leur avantage (la rigueur historique voudrait ici que j’introduise des nuances capitales, à savoir les chevaux, les arquebuses et l’ignorance dans laquelle se trouvaient les indigènes quant à l’origine de ces guerriers barbus, le tout conférant à ceux-ci une aura surnaturelle) : ces pourparlers préalables, d’apparence pacifique, durant lesquels les espagnols s’exposaient dangereusement du fait de leur vertigineuse infériorité numérique, quand il aurait suffi aux Mexicas comme aux Incas d’enfreindre le protocole diplomatique qui s’était tacitement mis en place entre deux partis ne partageant pourtant aucun référentiel commun, et donc de massacrer purement et simplement ces poignées d’hommes venus d’on ne sait où faire on ne sait quoi quand ceux-ci s’y attendaient le moins, ou du moins quand ils étaient le plus vulnérables (car en réalité, c’était sans doute bien ce qu’ils redoutaient, qu’on les assaillît à ce moment-là). Mais peut-être qu’au fond cela n’aurait rien changé, car la Conquista fut pavée de fiascos différant la conquête (il fallut par exemple deux expéditions bredouilles, parties vers le Yucatán — soit l’aire géographique des Mayas — depuis Cuba et violemment mises en échec dès la côte par des indiens agressifs, avant que Cortés ne s’en mêlât avec le succès qu’on sait), à la suite desquels une brèche était néanmoins ouverte, et les espagnols de revenir à la charge, jusqu’à ce qu’ils emportassent la mise. Peut-être donc que la bifurcation, dans un autre monde possible, de ces destins individuels n’aurait rien changé de décisif à la face du monde, si ce n’est les dates et batailles et patronymes enregistrés par l’Histoire, peut-être que les grandes civilisations précolombiennes étaient vouées quoi qu’il arrive, du fait justement de ces chevaux, de ces arquebuses, de ces barbes où coulaient des filets de bave véhiculant les irrépressibles épidémies à venir, à la chute face à l’envahisseur européen. Mais ne pouvant tout de même m’empêcher de me demander ce que serait le monde si la face en avait été changée, me demandant en outre si une uchronie de la sorte avait ou n’avait pas été écrite, me demandant enfin et surtout si elle pourrait être féconde, je me suis souvenu qu’elle l’avait été, écrite, au moins par un auteur contre qui, bien que ne l’ayant jamais lu, j’avais de fortes préventions, du fait de son appartenance à la caste honnie des têtes de gondole littéraires.
Continue ReadingLe paradis ne tenait qu’à l’absence de leur Dieu
Dans son impressionnant Christophe Colomb Héraut de l’apocalypse, Denis Crouzet tente, mais en historien rigoureux, de nous faire appréhender la découverte de l’Amérique depuis la perspective intime de l’Amiral de la Mer Océane, qui n’était selon lui ni un pionnier héroïque, ni un Hitler en herbe, ni un opportuniste mythomane, ni quelque homme théorique opérant une jonction imaginaire entre Anciens et Modernes, mais un illuminé de Dieu, accomplisseur messianique des prophéties d’Isaïe, se croyant vecteur malgré lui de la parole divine, l’élu devant conduire l’humanité entière à son salut, c’est-à-dire à la fois le ralliement des Indes, la conversion des Gentils, la reconquête de Jérusalem (ainsi que tout l’or nécessaire au financement d’une telle croisade), la fin (et donc le début) des Temps depuis le jardin d’Eden, soit le fourre-tout idiosyncratique d’un mystique autodidacte, interprétant toutes les vicissitudes de sa mission comme autant de signes à même de renforcer sa détermination, aussi contradictoires ou terribles fussent-ils (ainsi l’homme s’accommode-t-il, via les contorsions et clivages de sa voix intérieure, de ses erreurs et de ses échecs), ajustant sans cesse à leur aune le discours de ses relations de voyage. Nous sommes renvoyés à ces temps inconcevables pour nous où la géographie, lacunaire, était encore labile, où l’existence d’îles fantômes surgies d’anciennes rumeurs était attestée par les atlas et les portulans (Île de Saint-Brendan), où des cités mythiques, couvertes d’or, qu’habitaient cyclopes et hommes cynocéphales, somnolaient encore dans les ténèbres dans l’attente de l’Évangile.
Continue ReadingÀ quelle heure la marquise sortit-elle ?
Assouplissement (de l’esprit ?) à la négation puis, comme de juste, à la négation de la négation, ce serait ce qui apparenterait, mutatis mutandis, le surréalisme, pour tout ce qui touche à la sphère de la pensée ou du langage, au matérialisme historique, cantonné lui à la sphère socio-économique, selon une appréhension toute hégélienne du marxisme, si l’on en croit le Second manifeste du surréalisme, qui prend un tour drastiquement politique par rapport au premier, s’abreuvant quant à lui quasi-exclusivement aux sources freudiennes d’où jaillit l’inconscient (et partant, le rêve, l’imaginaire, le merveilleux, soit le terrain de jeu par excellence du surréalisme). On comprend qu’avec la pensée, on se situe tout de même un cran au-dessus de l’économique, même si Breton plaide avec fausse modestie la non-concurrence, l’étanchéité entre les deux sphères : entre les lignes, on le soupçonne plutôt de s’arroger un supplément de noblesse, le surplomb de l’abstrait (ne serait-ce d’ailleurs pas une sorte de contresens pour Marx, selon qui les conditions matérielles déterminent les idées ?).
Continue ReadingOuverture pour cent cinquante chapeaux-chinois
En quête d’une nouvelle voie d’appréhension critique du genre de régime, ou de système, sous la férule duquel nous vivons — du monde en somme — sans céder à l’antienne obligatoire qu’ânonne tout littéraire qui se respecte, ce déshérité revanchard : l’ogre capitalisme, cristal de tous les maux, principe névralgique d’où sont irriguées toutes les ramifications du vice. Commode cause dernière, mais comment s’extirper du mot qui seul suffit à décliner l’infini des préjudices, si nul n’échappe à sa logique, hormis le zadiste, l’autosuffisant, le Thoreau dans ses bois ? Toute marge annexée aussitôt qu’elle émerge, absorbée, digérée, fructifiée par les marchands, ainsi qu’ont dit Deleuze et Guattari, à moins que ce ne fût Baudrillard, à moins que ce ne fût Debord, à moins que ce ne fût l’École de Francfort, à moins que maints autres, ne serait-ce que Marx, bien sûr, déjà ? Qui nous fera voir ce problème sous un angle neuf ? (Ceci est une manière de préambule à d’autres réflexions : j’y reviendrai plus tard)
Continue ReadingMénage avec mon corps
« J’avais toute ma vie fait bon ménage avec mon corps ; j’avais implicitement compté sur sa docilité, sur sa force. Cette étroite alliance commençait à se dissoudre ; mon corps cessait de ne faire qu’un avec ma volonté, avec mon esprit, avec ce qu’il faut bien, maladroitement, que j’appelle mon âme ; le camarade intelligent d’autrefois n’était plus qu’un esclave qui rechigne à sa tâche. »
(Extrait des Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar)
Continue ReadingDe la supériorité de la littérature par rapport à la science
À propos de Cosmicomics d’Italo Calvino (traduction Jean Thibaudeau et Jean-Paul Manganaro)
La science a beau avoir prévu les trous noirs, puis fabriqué les télescopes rendant compte a posteriori du concept ; elle a beau avoir infailliblement mis en équation comme en pratique l’impossible ubiquité quantique ; elle a beau avoir élucidé le palimpseste qui machine par milliers nos macromolécules à partir d’un simple alphabet de quatre lettres ; elle a beau déduire toute la phylogenèse de quelques coquilles et fragments d’os, elle échoue par sa nature même, soit la réduction logique du réel ainsi décorrélé de la perception qu’on en a, circonvenant par approximations successives ses objets qui pourtant trouvent toujours quelque faille résiduelle par où se dérober encore à elle, le succès de ses trouvailles se mesurant alors proportionnellement à la distance qui bée toujours plus large entre ses symboles et l’entendement commun, elle échoue disais-je à nous faire éprouver de l’intérieur les phénomènes bien qu’elle — et pour cette raison même — les reconstitue toujours plus scrupuleusement, ses théories n’étant pour autant jamais, pour son plus grand malheur, superposables exactement à eux.
Continue ReadingÀ trop large échelle
Hasard de la sérendipité, juste avant La Pensée écologique, j’avais lu Une question de taille d’Olivier Rey, en tous points l’opposé du précédent, aussi sobre que l’autre est snob, aussi explicite que l’autre est elliptique, et si le livre de Morton, quoique prétendant mortifier les « bien-pensants », se réclame mine de rien du progressisme, c’est-à-dire du bon camp, on pourrait sans trop de risque qualifier de conservateur le livre d’Olivier Rey, au point qu’un historien de gauche en vue sur Twitter, tout en affirmant que ce livre l’avait profondément marqué, reconnaissait dans le même mouvement avoir depuis renié son auteur, et se garder de le citer, du fait de ses prises de position supposément réactionnaires, Olivier Rey s’étant notamment selon lui rendu coupable du crime de transphobie, étant entendu que toute objection, même prudente, aux déroutantes exigences trans vous vaut désormais séance tenante l’anathème automatique (oserais-je rapporter ici ce propos que m’avait tenu une ancienne collaboratrice, et qui me revient maintenant que j’y pense, jeune femme moderne — au sens de la jeune fille moderne gombrowiczienne — au style punk et gothique, féministe radicale participant à l’époque aux collages nocturnes dans Paris, insider autorisée peu suspecte donc de sympathies mal placées ; un propos de comptoir bien sûr hyperbolique, second degré, selon lequel, au sein des groupuscules politiques qu’elle fréquentait, les trans c’était des nazis, la jeune femme moderne voulant signifier par-là la toute particulière implacabilité de leur sectarisme idéologique. Bref…). Voilà donc quelqu’un, pour revenir à l’historien mentionné plus haut, qui, bien qu’adhérant sur le fond à une pensée fustigeant notre perte du sens de la mesure et de la juste proportion — car c’est là la problématique qu’explore sous maintes coutures Olivier Rey, en s’appuyant par exemple sur les critiques de l’école et de la médecine portées par Ivan Illich, en tant qu’institutions totalitaires s’octroyant abusivement une mainmise croissante sur tous les aspects, y compris les plus privés, de l’éducation et de la santé, ou encore en étendant à nos sociétés obèses et asservies par l’hybris technophile l’idée commune inaugurée par Galilée, selon qui « le monde ne saurait être invariant par changement d’échelle » : nous ne pouvons augmenter, densifier, accélérer, façonner et transformer indéfiniment notre milieu naturel et social sans perdre la juste taille d’échelle à laquelle ce milieu, dont nous sommes tributaires, reste viable pour nous — voilà donc quelqu’un, disais-je, qui refuse pourtant, par pur conformisme et soumission au catéchisme de l’époque, d’en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux excès de l’activisme — vouloir à tout prix des hommes enceints, n’est-ce pourtant pas l’hybris par excellence ? Re-bref : il me semble que ce n’était pas ça qu’initialement j’étais venu vous raconter ; mais qu’est-ce que j’étais venu vous raconter, au juste ?
Continue ReadingLes amibes et les cyborgs
Par la suite, glanant des interviews de Krasznahorkai, j’appris qu’il se disait très marqué par un livre de Timothy Morton (« Philosophe prophète de l’Anthropocène » selon The Guardian, et cité parmi les 50 penseurs les plus influents de 2020 par Prospect et Forbes, me dit Google Books) : La Pensée écologique. Confiant à tort en l’adage selon lequel les amis de mes amis sont mes amis, je l’empruntai donc à la médiathèque ; hélas, j’en fus pour mes frais, peu convaincu par cette philosophie typiquement post-moderne qui fourmille de références superficielles, faisant plus office d’alibis que de matière à dialectique, et masque mal, derrière des brumes sophistiquées, sa faible assise conceptuelle. Bien d’ailleurs qu’un nombre considérable de phrases, lassant à force, annonce répétitivement la délimitation du prédicat : « La pensée écologique, c’est… » (dans la traduction de Cécile Wajsbrot), on peine à saisir en quoi ladite pensée consiste exactement. Bien sûr, on voit bien que le philosophe prophète s’efforce d’abattre la frontière, rien d’autre qu’artificielle selon lui, entre nature et culture (et je vois bien aussi en quoi cela parle à Krasznahorkai, à qui je ne saurais tenir rigueur de cette affinité intellectuelle, tant son œuvre n’en continue pas moins de m’émerveiller), pourquoi pas, encore qu’une telle proposition mériterait d’être plus scrupuleusement explicitée, et peut difficilement se vanter, après Latour et Descola (nulle part cités, si mes souvenirs sont bons), d’être très novatrice. Alors oui, d’accord, la ville toute bitumée, bâtie à partir de matériaux extirpés de la terre par les animaux à gros cerveau que l’évolution a faits de nous, peut être considérée comme nature prolongée, quand bien même on n’y trouverait plus le moindre arbuste ni oiseau — et d’ailleurs, en réalité, on les y trouve encore, qui en outre s’y adaptent, n’est-ce donc pas la preuve du grand Tout inextricable ? On voit bien aussi qu’il cherche à miner la conception naïve selon laquelle il y aurait la gentille nature à préserver d’un côté, et la vilaine technique à réfréner de l’autre, car oui, d’accord, la nature est impitoyable par quelque bout qu’on la prenne, les tremblements de terre, les raz de marée, les éruptions volcaniques et les grizzlis c’est sans pitié (tout en fustigeant d’ailleurs cette forme de bien-pensance écologique qui fait preuve d’une indulgence immodérée envers une nature fantasmée, il ne s’interdit pourtant pas de glisser quelques discrets appels du pied en direction du camp progressiste, le seul auquel il conviendrait apparemment d’appartenir : voilà qui est bien consensuel pour qui croit écrire un décapant brûlot). On voit bien enfin qu’il prétend à une sorte de panthéisme transhumaniste où vivraient en parfaite symbiose les amibes et les cyborgs (ceux de de Donna Haraway), mettant toutes les espèces possibles dans le même sac et sur un pied d’égalité (en quoi il est pourtant contredit à mon avis par l’un des auteurs auquel il revient le plus souvent, Richard Dawkins qui, dans Le Gène égoïste, présente par analogie la culture humaine comme un processus évolutif émancipé de l’évolution génique, quoique émergeant de celle-ci) ; à cette fin il introduit la notion de « maillage » qui me paraît fort ressembler aux rhizomes de Deleuze et Guattari (pourtant le mot lui-même n’apparaît pas, bien que Deleuze soit incidemment cité une fois ou deux), et lui sert à réaffirmer que tout est dans tout, la Terre et ses soi-disant occupants et jusqu’à leurs terrifiantes technologies ne constituant en somme qu’un seul et même vibrant organisme, régi par des effets papillon en cascade. En conséquence, ou en prémisse je ne saurais dire, de quoi l’individu n’existe pas — nous voilà bien attrapés —, si ce n’est comme illusion à surmonter (on bâille un peu, on s’accroche, mais on ne saura jamais, nous pauvres mortels, comment la dépasser), assène-t-il un tantinet péremptoirement, s’autorisant cette fois des travaux du philosophe Derek Parfit, vers un article duquel il renvoie, dont je n’ai lu en ligne que la moitié car il est long comme un livre, mais qui m’a beaucoup amusé, puisqu’il s’agit d’une tortueuse tentative de démontrer, dans la plus tatillonne et scolastique tradition de la philosophie analytique, expériences de pensée aberrantes à l’appui (du type : s’il ne me reste qu’un hémisphère du cerveau, et qu’il est transplanté dans le crâne vide d’un autre organisme, cet autre organisme devient-il moi ?), que nous pourrions hypothétiquement nous affranchir du schème de personne, cette vieille idée selon laquelle, pour le dire vite, notre identité est déterminée, et qui a pour conséquence fâcheuse d’impliquer l’existence substantielle de quelque chose comme un ego, une âme ou une conscience…
Continue ReadingBéla ou László
Parmi les textes que je n’écrirai jamais, ou que j’écrirai peut-être un jour, il y a cette étude croisée des romans de László Krasznahorkai et des films qu’ils ont inspirés à son comparse Béla Tarr, étude dont les grandes lignes m’ont traversé l’esprit tandis que je visionnais la première partie de Sátántangó, adaptation fleuve par le second de l’œuvre du premier (à laquelle celui-ci a collaboré, en en écrivant le scénario, de même qu’il l’a fait pour Les Harmonies Werckmeister, tirées de sa Mélancolie de la résistance, ou Le Cheval de Turin, qui cette fois ne procédait d’aucun livre). Les idées que je formais alors me semblaient prometteuses, mieux encore, fulgurantes, mais tout écrivain honnête sait la difficulté de franchir la distance qu’il y a de la pensée (euphorique) à la page (laborieuse), et nombre de ces idées, faute d’avoir été mises encore fumantes à exécution, se sont évanouies depuis, ensevelies par l’incessant ronron du flux de conscience que happent mille autres préoccupations. Celle qui me reste, et que peut-être je restituerai trop pauvrement, la livrant sans pouvoir me replonger patiemment dans les textes et les films, est relative au fossé formel qui, à première vue, sépare les manières des deux hommes (et, partant, des deux arts) : autant est profuse l’écriture romanesque de Krasznahorkai, bien que généralement charpentée par une mince trame narrative et de vaporeux événements, autant elle s’écoule comme le torrent (comme peut être torrentiel, j’y reviens, le flux de conscience) dont monte petit à petit la crue jusqu’à son inéluctable débordement ; autant la mise en scène de Tarr est sèche, stationnaire (quoique n’interdisant pas le mouvement, tant qu’il ne fait que se répéter, infini prisonnier d’une boucle), où s’étire jusqu’à craquer la contemplation dans la durée. Ce sont deux rythmes sans rapport, sans commune mesure — on ne pourrait plaquer l’un sur l’autre — et pourtant ce mystère, le miracle qui opère : nul ne mettrait mieux que Tarr les mots de Krasznahorkai en images, alors même que, lisant ce dernier, on ne se représenterait jamais ce qu’y trouve à figurer le premier. Les styles radicalement divergent, mais l’effet produit, chacun y appropriant les ressources propres à son vecteur, converge : hypnotique et lancinant.
Continue ReadingDepuis un recoin de la littérature…
À propos du Sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz, traduction de Thérèse Douchy, Allan Kosko, Georges Sidre et Suzanne Arlet, dans la collection L’imaginaire de Gallimard
Difficile de résumer d’un mot le style de ces nouvelles de Bruno Schulz réunies sous le titre de la plus kafkaïenne d’entre elles, qui fait aussi penser au troublant roman du méconnu Hermann Kasack, La ville au-delà du fleuve, tant porteur de promesses d’ailleurs, celui-là, que sa fin laisse un peu le lecteur (en tout cas moi) sur sa faim, justement— à cause même peut-être de son twist, efficace mais banalisé depuis par Hollywood, presque convenu aux yeux des post-modernes épuisés que nous sommes (tel personnage qu’on croyait vivant (bien que très bizarrement vivant) depuis le début s’avère en fait mort, hantant une sorte de réalité parallèle).
Continue Reading