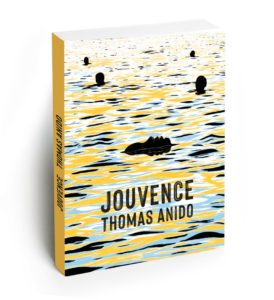Je me demande si les évolutionnistes, qui pour les plus acharnés d’entre eux s’adonnent à la fâcheuse tendance de tout expliquer par l’évolution, jusqu’au pli de votre pantalon — mais c’est un monisme comme un autre après tout, pas plus idiot que celui des sociologues qui expliquent tout quant à eux par le social, et dont d’ailleurs les évolutionnistes sont un peu les bêtes noires, œil pour œil, dent pour dent, capital génétique pour capital social — je me demande s’ils ont aussi réponse à la question du jeu chez les enfants (chez les primates ? chez les mammifères en général ? je n’ai pas l’impression par exemple que les jeunes poissons jouent ni les amibes ou les bactéries, quid des oiseaux ?). Je veux dire : la disposition innée des enfants au jeu, le fait que dès l’âge le plus tendre ils ne pensent qu’à jouer sans même savoir qu’ils jouent — et c’est là peut-être le trait le plus poétique de l’espèce, peut-être même la source de tout poème, hélas ça se gâte très vite ensuite, et le jeu devient plus tard pour l’adulte une opportunité commerciale, une gamme infinie d’articles à écouler par centaines de milliers pour Noël qu’on aura inventé par la même occasion — cette disposition doit bien constituer, par quelque voie aussi détournée fût-elle, un avantage sélectif favorisant un jour ou l’autre, une fois terminée l’enfance, la reproduction ; sinon, dirait l’évolutionniste, on ne jouerait pas. Ou peu d’enfants joueraient, le jeu ne disparaîtrait pas forcément pour autant, mais ne se serait pas imposé non plus comme un penchant aussi universel (imaginons des enfants naissant très sérieux, n’empilant pas des cubes, mais… faisant quoi à la place ? Entre leurs mains tout est tant jeu, imbriquer, tordre, mordre, casser, rouler, lancer, arranger — même ranger ! — qu’un opposé est difficile à concevoir ; ou est-ce notre définition même du concept qui est justement destinée à circonvenir la foule hétéroclite des comportements associés ?). C’est bien sûr une question toute rhétorique que je me pose là, sans quoi je serais allé chercher la réponse, puisqu’on a toutes les réponses de nos jours. J’ai cru voir après une rapide recherche, mais sans aller plus loin, que les cognitivistes — encore de fameux monistes, à tous les coups — interprétaient le jeu comme un exercice d’imitation des adultes, auquel recourraient les enfants avec les moyens du bord pour développer progressivement, par mimétisme, les mêmes facultés qu’eux. Suivant cette idée, les gènes du jeu, quels qu’ils soient, toujours soucieux comme on sait de se perpétuer, favoriseraient l’apprentissage de la vie, c’est-à-dire de la survie, et conséquemment l’atteinte en bonne santé de l’âge fertile. Mais cela n’expliquerait pas pour autant la forme, éminemment poétique disais-je, d’inconditionnelle gratuité, d’entier dévouement à la joie, que le jeu revêt, à moins que le plaisir ainsi procuré, constituant un attrait puissant, soit dès le départ une stratégie du gène pour inciter l’enfant à jouer, et donc à apprendre à survivre. Toujours est-il qu’après la puberté, une fois remplie la mission du jeu, on ne joue plus, ou si peu, ou si mal. Ou serait-ce que les adultes continuent à jouer, sans le savoir eux non plus, mais avec ce consternant sérieux qui les caractérise ? Ça donnerait alors la piteuse comédie du monde social. Serait-ce que, n’étant plus une question de vie ou de mort pour le gène, le jeu devient triste ?

Last modified: 26 février 2024