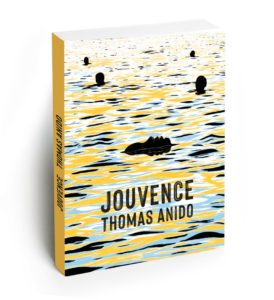Quand on s’intéresse à l’histoire de la Conquista, et à la manière dont quelques poignées d’hommes ont fait tomber des empires peuplés d’habitants par millions, on ne peut s’empêcher de se demander : que se serait-il passé si Cortés n’avait pas défait Moctezuma, si Pizarro n’avait pas défait Atahualpa, comme ils y sont parvenus tous deux avec des tactiques sensiblement similaires, si l’on fait abstraction des contextes et phases d’approche en revanche bien différents, Pizarro s’étant longuement enlisé dans les mangroves de la côté pacifique de l’actuel Équateur, errant des années sans perspective concrète avant d’enfin trouver une ouverture prometteuse, en l’occurrence en direction de la ville andine de Cajamarca, tandis que Cortés a tracé sa route, semée d’embûches certes, à travers le Mexique avec d’emblée la certitude qu’il y avait là quelque part derrière quelque chose à prendre, même s’il ne savait pas encore quoi avant d’arriver à Mexico-Tenochtitlan. Tactiques similaires coïncidant, en gros, par une inconscience salutaire des forces réelles en présence, par un habile double jeu attisant les dissidences locales, et surtout par la spectaculaire prise en otage du souverain suprême qui a sonné le glas de chacun des deux empires. On ne peut s’empêcher d’imaginer que les choses auraient pu tourner différemment, parce que dans les deux cas il y eut au moins une occasion pour les autochtones de profiter du rapport de force démesurément à leur avantage (la rigueur historique voudrait ici que j’introduise des nuances capitales, à savoir les chevaux, les arquebuses et l’ignorance dans laquelle se trouvaient les indigènes quant à l’origine de ces guerriers barbus, le tout conférant à ceux-ci une aura surnaturelle) : ces pourparlers préalables, d’apparence pacifique, durant lesquels les espagnols s’exposaient dangereusement du fait de leur vertigineuse infériorité numérique, quand il aurait suffi aux Mexicas comme aux Incas d’enfreindre le protocole diplomatique qui s’était tacitement mis en place entre deux partis ne partageant pourtant aucun référentiel commun, et donc de massacrer purement et simplement ces poignées d’hommes venus d’on ne sait où faire on ne sait quoi quand ceux-ci s’y attendaient le moins, ou du moins quand ils étaient le plus vulnérables (car en réalité, c’était sans doute bien ce qu’ils redoutaient, qu’on les assaillît à ce moment-là). Mais peut-être qu’au fond cela n’aurait rien changé, car la Conquista fut pavée de fiascos différant la conquête (il fallut par exemple deux expéditions bredouilles, parties vers le Yucatán — soit l’aire géographique des Mayas — depuis Cuba et violemment mises en échec dès la côte par des indiens agressifs, avant que Cortés ne s’en mêlât avec le succès qu’on sait), à la suite desquels une brèche était néanmoins ouverte, et les espagnols de revenir à la charge, jusqu’à ce qu’ils emportassent la mise. Peut-être donc que la bifurcation, dans un autre monde possible, de ces destins individuels n’aurait rien changé de décisif à la face du monde, si ce n’est les dates et batailles et patronymes enregistrés par l’Histoire, peut-être que les grandes civilisations précolombiennes étaient vouées quoi qu’il arrive, du fait justement de ces chevaux, de ces arquebuses, de ces barbes où coulaient des filets de bave véhiculant les irrépressibles épidémies à venir, à la chute face à l’envahisseur européen. Mais ne pouvant tout de même m’empêcher de me demander ce que serait le monde si la face en avait été changée, me demandant en outre si une uchronie de la sorte avait ou n’avait pas été écrite, me demandant enfin et surtout si elle pourrait être féconde, je me suis souvenu qu’elle l’avait été, écrite, au moins par un auteur contre qui, bien que ne l’ayant jamais lu, j’avais de fortes préventions, du fait de son appartenance à la caste honnie des têtes de gondole littéraires.
Dans Civilizations, Laurent Binet fait bifurquer l’histoire plus tôt : Christophe Colomb et ses hommes ne sont tout simplement jamais revenus des Caraïbes, et donc du point de vue de l’Europe, l’Amérique n’a jamais été découverte. Et pourquoi n’en sont-ils jamais revenus ? Parce que l’histoire avait déjà bifurqué bien avant eux : les vikings de l’an mil ne se sont pas contentés de fonder une colonie sur l’île de Terre-Neuve au Canada, le Vinland, mais ils ont ensuite poursuivi leur voyage vers le sud, traversant le Golfe du Mexique, accostant à Cuba, enjambant l’isthme de Panama, s’aventurant jusqu’aux Andes, se liant d’amitié à chaque étape avec les locaux, leur apportant chevaux et bovins, leur enseignant la forge du fer et les immunisant, au prix de quelques pertes sur le moment, contre ces virus inconnus en ces parages, les armant ainsi d’avance pour se confronter aux européens quelques siècles plus tard, de sorte que les Taïnos de Cuba purent mettre Colomb en déroute et tuer ses hommes jusqu’au dernier, le tout débouchant par une suite de péripéties que je vous épargne sur une Conquista inversée, culminant avec le règne des Incas et des Mexicas sur l’Europe (passons également sous silence l’épilogue mettant en scène Cervantes, Montaigne et Le Greco, parce qu’il est tout bonnement catastrophique).
Et dès le début, dès la première page en fait, les grossières coutures de Binet sautent aux yeux, tous ces petits engrenages qu’il calcule et dissémine opportunément pour dérouler son programme uchronique dont les causes et les effets s’enclenchent sans le moindre accroc, au point que bien souvent le lecteur peut les deviner et les anticiper avec plusieurs pages d’avance, son programme froid qui tourne comme une machine impeccable, rutilante, mais à vide et sans âme. On sent qu’il a bien potassé ses bouquins d’histoire, pour en détourner le moindre événement à son profit, nous assénant à longueur de page ses clins d’œil putassiers, « regardez comme chuis malin » semble-t-il nous dire à chaque ligne, et « regardez comme j’ai bien potassé mes bouquins d’histoire », nous martèle-t-il en se rengorgeant d’érudition — mais une érudition de surface, une érudition mimée —, croyant ce faisant nous rendre crédible, palpable, son monde possible qui, prenant vie sous nos yeux, s’imposerait comme le brillant tour de force d’un démiurge. Sauf que c’est bien plutôt une chose morte, un théâtre de marionnettes sonnant désespérément creux dont on tourne les pages avec ennui, un ennui décuplé quand la litanie des événements détournés s’accélère, le narrateur, qui ne sait jamais vraiment très bien s’il joue à l’historien ou au chroniqueur d’époque ou au parodiste — mais un parodiste dont les rares traits d’humour feraient tous flop —, se mettant par endroits à nous assommer en rafale de détails circonstanciels à seule fin de nous faire voir combien sa machine est efficace et perfectionnée. Lisant un tel pensum je me demande surtout quel intérêt a bien pu trouver son auteur à dérouler un programme à ce point millimétré et sans surprise — nul doute que lui croit nous en distribuer des pelletées à chaque page, de surprises —, quel plaisir il a bien pu prendre à l’écrire — ce voyage exploratoire, cette conquête de l’informe en soi en quoi consiste l’écriture et qui fait endurer mille tourments à qui l’entreprend — et je m’effraie presque de la conception affreusement mesquine qu’il semble avoir de ce qu’on appelle la « création littéraire » : démouler de l’épate-bourgeois au kilomètre.
Le plus navrant c’est qu’il était sans doute persuadé de livrer là un vibrant hommage à la civilisation disparue des Incas, sans jamais être pourtant capable de rendre compte de sa radicale altérité : c’est qu’il ne suffit pas d’évoquer de-ci de-là les nœuds tressés des quipus, sorte d’équivalent andin des bouliers, de nous vendre la mita, ce temps de travail obligatoire au service de l’Inca, comme un progrès social par rapport au prélèvement de l’impôt, d’injecter lourdement quelques vagues quiproquos culturels, pour saisir l’indicible de l’intérieur : l’Europe découverte à travers les yeux de l’Inca.
Peut-être tiens-je alors la réponse à ma question : peut-être cette uchronie est-elle un projet stérile, peut-être qu’elle ne nous dira rien du mystère Inca ou Mexica, et que la seule Conquista inversée possible, c’est par exemple celle, inspirée de faits réels dans le film hallucinatoire Cabeza de Vaca, vécue par le conquistador éponyme, échoué en Floride, capturé par une tribu primitive puis vendu comme esclave à deux rebouteux ambulants après le massacre de sa troupe, et devenant l’un des leurs au contact des indigènes, officiant même, au terme de son initiation, comme puissant chaman guérisseur parmi eux pour qui il finit par prendre fait et cause quand il retombe, au bout de sa route, sur des espagnols qui les traitent comme un vulgaire bétail.

Last modified: 22 novembre 2024