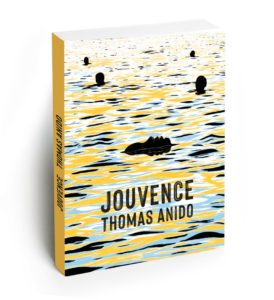L’an dernier, à la fin du premier confinement (le vrai, le dur !), j’ai voulu lire L’idéologie allemande écrite par Marx et Engels entre l’été 1845 et le printemps 1846. L’envie m’en est venue par coïncidence : alors que je venais de finir L’Origine des espèces, je tombai sur une interview du sociologue Bernard Lahire où il disait relire invariablement chaque année et le livre de Darwin et celui de Marx, considérant les deux comme des échafaudages intellectuels exemplaires.
Je n’ai pu trouver qu’une édition scolaire[1], annotée en marge, de la première partie de ce texte posthume, intitulée Feuerbach, et constituant en fait, si j’ai bien compris, une sorte de synthèse d’une critique beaucoup plus étendue (dont d’ailleurs certains fragments sont perdus) et violemment satirique à l’encontre du groupe des « jeunes hégéliens » : Bruno Bauer, Max Stirner et d’autres, désignés sous le sobriquet de « sainte famille » (les critiques adressées à Feuerbach, pour qui Engels et Marx manifestent plus d’estime, restant plus nuancées).
L’idéologie allemande est un livre important parce qu’y sont posés les premiers jalons du matérialisme historique qui, en portant un coup fatal à l’idéalisme, devait influer en profondeur sur le cours des sciences humaines (et accessoirement, sur celui de l’histoire…). N’ayant pas l’intention, quand bien même c’est une œuvre essentielle, de me farcir l’énorme Capital, il me convenait bien que le texte fût relativement court tout en exposant le fondement de la méthode de Marx, auteur dont je me disais qu’il fallait l’avoir lu une fois au moins dans sa vie, aussi brièvement fût-ce.
Et si l’on sent bien à la lecture — alors que Marx et Engels identifient la division du travail, caractérisée par les rapports de production, comme « une des puissances principales de l’histoire » — que se joue là une percée décisive de l’esprit, c’est un autre aspect du texte qui m’a frappé : la question de la révolution.
Car, autant le concept de lutte des classes comme moteur de l’histoire ou l’idée que les individus sont déterminés par leurs conditions d’existence, constituent des avancées scientifiques (en ce que ce sont des tentatives de modélisation pertinentes de phénomènes sociaux), autant m’ont plutôt fait l’effet d’imprécations mystiques (dans le sens où Wittgenstein entendait ce dernier mot) les appels répétés au « bouleversement de l’état social existant par la révolution communiste », à « révolutionner le monde existant » et à « transformer pratiquement les choses données », au premier rang desquelles la propriété privée : « c’est alors que la libération de chaque individu s’imposera dans la mesure où l’histoire se sera transformée complètement en histoire universelle ». L’on se demande alors en quoi tout cela est « fondé empiriquement », ainsi qu’il l’affirme.
Non pas que, à peine éclos, j’aie rencontré là pour la première fois la volonté de bouleverser l’ordre établi qui préside à toutes les utopies, y compris à celles qui furent antérieures à Marx, mais c’est bien à l’instant où je la lus chez lui selon ma conformation spirituelle du moment qu’elle m’apparut, pour ainsi dire, dans toute sa folie.
Les révolutions en sont-elles vraiment ? Le mot n’entretient-il pas une connotation romantique qui outrepasse la portée réelle de l’événement ? La Révolution française a-t-elle révolutionné la société française ? Pas tant qu’on voudrait le croire, semble-t-il, si ce n’est qu’elle a accéléré un processus inéluctable, engagé avant elle, sans empêcher pour autant les régressions qui lui ont succédé. Dans son cas, on pourrait tout aussi bien parler, peut-être, de renversement anticipé.
Justement, c’est parce que c’était avant Marx, dira-t-on. En 1917, armée d’un outil théorique approprié, la transformation volontariste a bien eu lieu, et s’est maintenue dans le temps. En effet, et pour quel résultat… C’est qu’on a cru qu’il suffisait de transformer la société pour transformer les hommes. À tort : la prise de conscience idéologique, le soulèvement politique ne fondent pas en soi une éthique, aussi juste soit la cause, et aucune révolution n’abolira jamais ni l’avarice ni l’envie ni la paresse ni la gourmandise ni l’orgueil ni la luxure ni la colère. L’homme nouveau ne peut advenir que par la force ; autant dire qu’il n’advient jamais — il louvoie. L’arracher à ses habitudes, ce n’est pas le changer en mieux. Je me souviens, voyageant à Cuba en 2012, alors que le système collectiviste était déjà bien imprégné de libéralisme, d’avoir été sidéré par la schizophrénie que manifestaient les habitants dans leurs moindres activités quotidiennes, obligés de glorifier publiquement le régime tout en contournant dès que possible, dans la clandestinité, ses lois intenables ; c’était pour eux rien de moins que la condition de leur survie.
L’éthique est une question de discipline individuelle, non pas de volonté collective, et l’on ne peut envisager d’améliorer la société qu’à partir de l’homme tel qu’il est.
Finalement, ce bon vieux Marx m’a tout l’air d’avoir été un grand idéaliste…

[1] Editions Nathan, traduction de Hans Hildenbrand
Last modified: 20 avril 2021