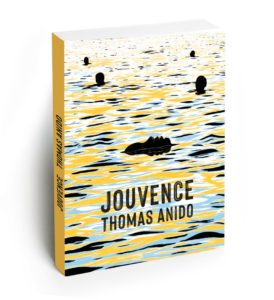Si l’on voulait schématiser à l’excès — et Dieu sait s’il est délicat de le faire au sujet d’un tel livre — on pourrait tenir cette ambition exprimée à la page 103 : « écrire une autre langue dans sa langue » pour la meilleure synthèse du projet littéraire, éminemment stylisé, de Marien Defalvard. Sous l’étiquette de « roman » inscrite en couverture, puisqu’il a bien fallu que l’éditeur se raccroche à quelque catégorie identificatoire à l’attention de ses clients, on a bien plutôt affaire à une ondoyante méditation poétique, spirituelle, topographique, qu’encombreraient presque les minces repères censément narratifs noyés dans le flux introspectif du narrateur, faux double prétexte de l’auteur.
Il y a presque même une anomalie — ou serait-ce une coquetterie ? — à voir un livre à ce point singulier, et disons-le, au bord de l’illisibilité, publié chez un éditeur aussi mainstream que Fayard ; mais n’était-ce pas déjà une anomalie que le premier roman de Defalvard, Du temps qu’on existait (Grasset), fût couronné du Prix de Flore, le bouffon Beigbeder accotant ainsi ce tout jeune prodige au palmarès parmi d’insignifiantes Angot, Despentes ou Nothomb ? C’était déjà un livre difficile, mais flamboyant, inclassable, que je n’étais alors pas parvenu à achever. Je suis pourtant de ces lecteurs qui vont, quoi qu’il leur en coûte, et bien que parfois des pans entiers leur en échappent, au bout des lectures qu’ils se sont choisies, mais j’entrepris celle-ci durant la seule période de ma vie d’adulte — les trois mois succédant à la naissance de mon fils — où je fus incapable, épuisé mais surtout bouleversé de fond en comble, de finir aucun livre, et Le livre de l’intranquillité de Pessoa et d’autres que j’entamai sans doute mais dont je ne me souviens plus en firent aussi les frais (c’est d’ailleurs à cette occasion que j’appris enfin à me permettre d’abandonner certains livres en cours de route, même si cela ne m’arrive toujours que rarement et depuis, par exemple, les trop maniérées et barbantes — et à la fois trop visiblement empressées de choquer le bourgeois à bon compte — Pompes funèbres de Jean Genet, le trop glacial et vainement cérébral Locus Solus de Raymond Roussel ont rejoint mon purgatoire personnel des livres en suspens).
« Écrire une autre langue dans sa langue » donc : extrême sophistication d’une matière qui semble pourtant découler d’une virtuosité fluide (le texte aurait été écrit en six mois), tressage fleuve d’images et de conceptions ambigument contre-intuitives, poudroiement de références dénotées souvent de façon cryptique — non pas certes poudre aux yeux de savant vaniteux, mais érudition ubiquiste, où s’enroulent littérature, métaphysique, théologie, histoire, géographie etc., érudition si naturellement convoquée qu’elle en devient intimidante pour le lecteur — c’est « une autre langue dans sa langue » au sens, peut-être, où la parole, les images qui nous sont livrées n’ont pas été préalablement échafaudées, calculées, pour que chacun puisse ensuite les décoder, en sens inverse, selon son propre référentiel évocatoire, mais seraient comme l’expression non apprivoisée d’une langue pour initiés dont le seul initié possible serait justement son scripteur ; langue extérieure restituant sans concessions communicationnelles le magma intérieur des intentions poétiques, ou faisant écho à « un arrière-texte qui est un arrière-monde aussi peu partageable qu’un inconscient », comme le dit l’auteur lui-même, digne héritier en cela de la langue « brouillée » de Carlo Emilio Gadda qui apparaît, il ne s’en cache pas, comme son plus prégnant modèle.
Avec ses entrées datées, le livre se présente comme le journal d’un architecte revenu à Clermont-Ferrand pour soumettre à la préfecture le projet d’un bâtiment — « J’étais décidé à proposer ceci : une architecture catholique, un gallicanisme parfait, qui nie absolument tout ce qui pouvait se tramer dans la trame médiocre de nos existences individuelles. » — et cette maigre ossature, quasi imperceptible en fait, moins que filigrane, lui donne l’occasion d’errer dans la ville qui fut celle de son enfance et de sa jeunesse, où il constate la catastrophe advenue — « la catastrophe se montrait dans la ruine volontaire, dans la destruction volontaire, dans tout cet espace minutieusement, désirablement ruiné, rendu présentable pour toutes les forces négatives, temporelles, pour toutes les pulsions affichées sur les banderoles au fronton des municipalités » — la laideur et la disharmonie, la casse du symbole engendrées par l’urbanisme pharmaceutique voué à la prophylaxie sociale, par la planification tous azimuts et paradoxalement anomique, d’où toute velléité de transcendance aurait été consciencieusement expurgée, d’où aurait été bannie toute autre raison de vivre que l’administration efficiente d’un désir autotélique, d’une jouissance sans frein, commodément rebaptisés par le contemporain sous le mensonge de liberté. Cette structure en état de décomposition avancée, ce cadavre d’architecture — car l’habitat et l’institution collective, en tant que constructions normatives, dogmatiques (ici Defalvard rejoint manifestement Pierre Legendre), sont bien des structures au sens anthropologique, autrement plus concrètes au fond que celles, insaisissables et discursives, décrétées alpha et oméga du social par le courant structuraliste — arpenté, si je puis dire, sous toutes les coutures, est mis en regard d’une autre structure, cet instrument aux potentialités qu’on croyait infinies mais pourtant bien devenu carcan, soit le langage — « Il faudrait dire un jour pour de bon ce qu’il y a d’acceptation absolue dans l’emploi d’un simple mot, de soumission sans distance à la réalité qu’il désigne » — et « son emprise entière […] sur la conscience », cette turbine infatigable : « la conscience ne cessait jamais son broyage continu et destructeur, même lorsqu’il s’agissait de mordre dans une tartine de pain grillée épaissement beurrée jusqu’aux bords ; la tartine et le geste de mordre dedans entraient dans l’enchaînement incessant et névrotique des réalités intérieures, du remâchage spiritualiste ». Avec le langage nous vient le sens, autrement dit la connaissance, la Chute qui nous sépare irrémédiablement du paradis sensoriel, de « l’événement pur » avec qui nous n’étions qu’un, du « magnétisme d’une image qui aurait eu lieu avant que la conscience sache ce que les penseurs, depuis l’orée du monde, depuis les présocratiques et leurs tâtonnements hagards de bêtes blessées, en avaient dit, en avaient fait ». Est-ce à dire que, pour Defalvard, fervent chrétien semble-t-il, la religion est pervertie d’emblée, en son principe même, par le langage ? Ou serait-ce que, malgré ses impulsions religieuses, l’homme est une bête irrémédiablement païenne ?
Ces trois thèmes — architecture, littérature, religion — inextricablement noués à d’autres (le collectivisme démocratique, la relation au père honni, la sculpture du corps comme ultime refuge individualiste de la transcendance, le remembrement du paysage, le Massif Central et l’Espagne d’antan, parmi des références répétées à Pascal, Stendhal, Gracq, Michelet, Girard, Montherlant etc., et même à la toute fin du livre, quelques paragraphes étonnants à propos de la folie de Nietzsche, que Defalvard n’a pourtant pas l’air d’apprécier, comme s’il rendait là hommage, malgré tout, à son implacable lucidité) s’organisent en circonvolutions désabusées autour d’un constat : le naufrage esthétique et moral, la dégénérescence même, de la civilisation occidentale moderne, ou post-moderne, comme on voudra, dont il se fait juge, certes, mais sans parti, nostalgique peut-être mais non moins fataliste, en cela moins assimilable au réactionnariat, moins partisan d’une contre-réforme que ne pourrait sans doute être tenté de le croire le lecteur progressiste, comme en témoigne notamment cette citation de Baudrillard : « Il faut vivre en intelligence avec le système, mais en révolte contre ses conséquences, il faut vivre avec l’idée que nous avons survécu au pire » ou cette idée, formulée par le fonctionnaire de la préfecture, alors qu’il s’apprête à signifier au narrateur le rejet de son projet architectural : « On ne sauvera rien, rien, rien. »
Il en résulte un livre hors norme, l’œuvre assurément virtuose d’un surdoué, suscitant à la lecture une sorte d’envoûtement mélancolique, ridiculisant au passage les déconstructionnistes contemporains qui, sous prétexte de « réinventer la littérature » (sotte scie !), s’adonnent au charabia ; mais paradoxalement, alors même que Defalvard prétend au souffle vertigineusement fluide, il finit par ériger une sorte de monolithe marmoréen, une citadelle imprenable, hermétique et sans vie, vouant à la longue le lecteur à l’ennui. « Ma dépendance aux mots était une dépendance de drogué » écrit-il, et n’est-ce pas justement le problème, ce fétichisme des mots — au point qu’on apprend du vocabulaire à chaque page, ah ça oui, pour peu qu’on prenne le temps d’ouvrir un dictionnaire… — soumis sans distance aux réalités qu’ils désignent ? Peut-être faut-il accepter, comme le regrette d’ailleurs Defalvard à sa manière, que le monde ne soit pas constitué des choses que désignent les mots, mais bien plutôt (avec Wittgenstein) des faits qui relient ces choses entre elles et que les mots nous servent à illustrer ? Ainsi peut-être cessera-t-on de considérer exclusivement les mots comme des choses — aussi habile soit on à les détourner et les faire jouer — afin d’insuffler à l’écriture la vie, l’humour et l’invention romanesques, soit toute la distance qui sépare encore Defalvard du modèle qu’il revendique : Carlo Emilio Gadda.

Last modified: 11 octobre 2021