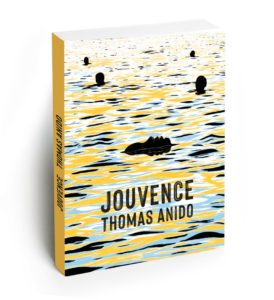Lire l’épisode précédent : où l’on ne sait pas faire grand-chose de ses dix doigts
Pour conclure sur cette idée du vrai communisme qui n’a jamais été essayé, et puisqu’il serait trop facile de lui opposer comme d’habitude les désastres Mao et Staline, attardons-nous sur un épisode plus lointain et méconnu : les missions jésuites du Paraguay aux XVIIe et XVIIIe siècles. La puissante compagnie de Jésus avait réussi à créer une sorte d’enclave dans les colonies d’Amérique du Sud, soustrayant les indigènes guaranis à la mainmise esclavagiste des colons espagnols et portugais, obtenant même à cette fin la protection d’une ordonnance royale édictée à Valladolid en 1607.
C’était alors, et je laisse la parole à Michel Foucault en personne qui le raconte dans une conférence radiophonique de 1966 (à partir de 27min 40s, pour les plus curieux), « une colonie merveilleuse, dans laquelle la vie tout entière était réglementée, le régime du communisme le plus parfait régnait, puisque les terres appartenaient à tout le monde, les troupeaux appartenaient à tout le monde. » L’agriculture, l’élevage et l’artisanat étaient collectivisés, les fruits de ce travail répartis équitablement entre tous — à chacun selon ses besoins — au sein d’une société fermée sur elle-même, sans marché ni monnaie, et que rythmait le sévère encadrement éducatif et religieux des jésuites qui ne négligeaient pas pour autant de lâcher un peu la bride au syncrétisme, tant que le folklore guarani n’empiétait pas trop sur les commandements les plus impérieux de la foi chrétienne. Les jésuites armaient et formaient même la milice chargée de défendre les villages contre les raids des bandeirantes en quête d’esclaves et, fait notable, géraient de main de maître le commerce extérieur, seul point de contact des missions avec le monde, générant via une judicieuse stratégie business d’import-export des « bénéfices considérables » (Foucault encore) pour la compagnie de Jésus, et la plus grande gloire d’icelui.
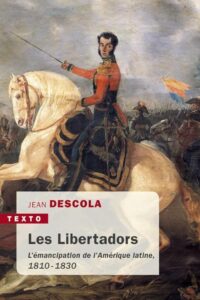
Mais l’enclave suscitant toutes sortes de convoitises, la protection royale dont elle bénéficiait s’effrita. Elle eut à résister héroïquement à l’Espagne et au Portugal, la première ayant cédé le territoire au second en 1750, les deux s’unissant pour tenter de faire évacuer les missions par la force ; celles-ci tinrent bon, mais ne purent se remettre en revanche de l’expulsion des jésuites ordonnée en 1767, devenus il faut croire trop encombrants pour la Couronne comme pour le Vatican, décrétés indésirables sur tout le continent, arrêtés et embarqués manu militari pour l’Europe. Comme le raconte Jean Descola (le père de Philippe !) dans son livre Les Libertadors, échaudé par la guerre de 1750, la marquis de Bucarelli, gouverneur du Río de la Plata, juge alors plus prudent d’exempter les jésuites du Paraguay de l’édit de proscription, craignant d’échouer s’il emploie de nouveau la manière forte. À la place, et pour s’assurer la bonne volonté des guaranis, il convoque ces derniers à Buenos Aires, les reçoit en grande pompe et leur fait miroiter, avec la fin de la tutelle des jésuites, l’accession à la citoyenneté espagnole et à une certaine forme d’indépendance. Bien sûr, c’était une promesse en l’air, car dans les faits les guaranis deviendraient bien vite la proie de la rapacité des colons et de l’administration, mais — et c’est là que je voulais en venir — la réaction des guaranis fut éloquente : ils se firent retourner comme un gant (l’expression est de Descola, qui cite aussi l’explorateur français Bougainville, assistant à ces tractations et trouvant aux indigènes « un air stupide d’animaux pris au piège »). Alors seulement les jésuites du Paraguay furent expulsés à leur tour, sans que les guaranis n’eussent « un geste pour retenir leurs pères […], ni pour les défendre. » Si cette utopie communiste exemplaire avait été aussi paradisiaque que Foucault l’a prétendu, les guaranis y auraient-ils renoncé si promptement — quand bien même ils le firent en concluant un marché de dupe —, et se serait-elle désagrégée en un temps record sans laisser d’autres traces que quelques ruines ensevelies sous la végétation, à la seconde même pour ainsi dire où leurs maîtres furent enlevés aux indiens, ceux-ci s’en retournant alors à leur vie d’avant dans la forêt ou s’en allant au contraire s’asservir, malgré eux et pour le pire, à la société coloniale ? N’est-ce pas plutôt à dire que son maintien ne tenait qu’à un fil, à savoir la main de fer de ceux qui la dirigeaient ? Cette utopie, les guaranis l’avaient-ils choisie, ou s’y étaient-ils docilement soumis, faute de mieux, comme l’aurait fait peut-être — et le mot n’est pas de moi mais d’Edgar Quinet, peu tendre pour sa part envers le projet des religieux — un peuple enfant ?
Lire la suite : où l’on s’aventure sur un terrain peu familier

Last modified: 13 mai 2025