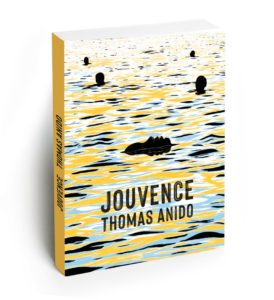Lire l’épisode précédent : où l’on confesse un conflit de loyauté
Ce qui me reconduit à mon point de départ, qui est aussi l’autre raison de ma digression : la défense de ces fameux chiffres auxquels le poète reproche leur froide inhumanité. Au moment même où l’homme s’est livré corps et âme à la domination du chiffre, on dirait aussi que le chiffre, la statistique, c’est tout ce qui lui reste pour y voir clair, tant tout a pris des dimensions impénétrables à vue de nez : une sorte très paradoxale d’empirisme platonicien soumis à la loi des grands nombres — c’est dire si nous sommes dans de beaux draps ! Dans mon exemple du Chili d’Allende, comment ne pas s’interroger sur le bien-fondé d’un programme, aussi exaltant soit-il sur le papier, qui fait passer le taux d’inflation annuel de 30% à 600% en moins de trois ans, et comment ne pas douter de la validité de ses présupposés idéologiques ?
Des chiffres tels que celui-ci capturent quelque chose de la réalité, bien qu’ils ne renvoient à aucune entité palpable, aucune chose en soi, étant à la fois agrégats et artifices, à savoir en l’occurrence le fruit d’une construction calculatoire : l’évolution au fil du temps de la moyenne des prix d’un échantillon de produits considérés comme représentatifs etc. (Et peut-être que dans le cas de mon exemple historique, le calcul se compliquera d’hypothèses, de paramètres et de retraitements nécessaires pour pallier d’éventuels trous dans la raquette, puisqu’on peut supposer que les auteurs n’avaient pas forcément accès à des données impeccablement exhaustives : quid de toutes les opérations de collecte, de traitement et d’archivage à une époque sans informatique ? Qui relevait quels prix mois après mois, pour les répertorier où, avec quelles failles dans le processus ?) Néanmoins ce chiffre abstrait, car à la fois beaucoup trop général et composite, synthétise à lui seul une foule de phénomènes concrets, vécus, s’enchaînant en cascade : prix des biens de première nécessité décuplés du jour au lendemain, décrochage entre la valeur nominale d’un billet et le pouvoir d’achat correspondant (pensez aux fameuses charrettes de billets dans l’Allemagne des années 1930), repli sur le troc et le marché noir, pénuries alimentaires, effondrement de l’activité, explosion du chômage, misère croissant à vue d’œil, etc. Le chiffre de l’inflation, quand il atteint ces proportions, capture quelque chose de la réalité, une sorte d’essence d’un genre particulier, dans le sens où l’agglomérat de faits qu’il encapsule n’est pas sujet à interprétation : personne n’irait affirmer que, selon le point de vue, une inflation de 600% peut être considérée comme une bonne ou une mauvaise chose. C’est objectivement une catastrophe dont les répercussions sont nécessairement douloureuses. On peut s’opposer sur ses causes, mais il n’y a rien à discuter sur la nocivité de ce qu’évoque le chiffre en lui-même. Or, ce que s’efforcent de démontrer les auteurs de l’étude, en s’abstrayant sciemment des controverses politiques (ce qui ne manquerait pas d’indigner tout tenant du « tout est politique »), c’est que très vraisemblablement lesdites causes sont inhérentes au projet économique du gouvernement chilien, et non pas le fruit d’un sabotage exogène. Que ce dernier ait pu accélérer la crise, certes oui, mais en tant lui-même que conséquence de celle-ci, venant grossir la boule de neige. En comparant cet épisode à celui, très semblable dans ses causes et ses effets, de la présidence d’Alan Garcia au Pérou quinze ans plus tard, ils cherchent à établir une corrélation forte entre les deux mécanismes à l’œuvre : aussi louables les intentions du populisme macroéconomique fussent-elles, les chiffres invalident catégoriquement la façon dont on a prétendu les mettre en pratique. Nul besoin d’être un conséquentialiste forcené pour en convenir.
Lire la suite : où l’on ne choisit pas ses exemples au hasard

Last modified: 13 mai 2025