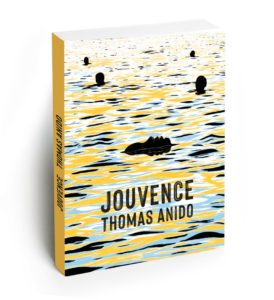À propos de Nadie Nada Nunca de Juan José Saer (Éditions Le Tripode, Traduction Laure Bataillon)
Des chevaux inexplicablement tués en série dans les environs du village de Rincón, coin d’ordinaire sans histoires comme son nom l’indique, dont on comprend qu’il est situé le long du Rio Parana dans la province de Santa Fe, ou quelque part approchant, une pampa brûlante au mois de février, el mes irreal, équidistante des luxuriances d’Iguazú et de Buenos Aires, et accessoirement pays natal de Saer :
non seulement l’intrigue est secondaire, elle n’intéresse qu’éventuellement les protagonistes, comme toile de fond, au titre de menace diffuse qui peut comme peut ne pas s’abattre sur le cheval bai (el bayo amarillo) autour duquel gravitent le Bancal, son propriétaire, ainsi surnommé parce qu’il a les épaules déjetées (los hombros torcidos) ; le Chat, à qui le Bancal en a confié la garde ; Elisa qui séjourne chez le Chat son amant ; le maître nageur enfin qui surveille la plage sur laquelle donne la maison du Chat, constituant à eux quatre les premier (le Chat et Elisa) et second (le Bancal et la maître-nageur) cercles du roman, dans la phénoménologie perceptuelle desquels nous embarque Saer, et auquel il adjoint sur le tard, mais de manière plus périphérique, Tomatis, figure leitmotiv de ses romans, d’abord seulement évoqué au discours indirect par Elisa et le Chat, puis rendant visite à ceux-ci en chair et en os pour partager avec eux un asado — non seulement l’intrigue est secondaire, réduite à une rumeur, un souci — que n’apparaisse point, subite, silencieuse, la main avec le revolver et qu’elle n’appuie pas le canon, avec douceur, contre la tête du cheval. Que l’explosion ne retentisse pas. — voire une pensée parmi d’autres, une virtualité rôdant dans un rayon plus ou moins vaste autour de la maison dont on va et vient entre les pièces, passant de la chambre à la cuisine et de la cuisine à la chambre et de la cuisine à la galerie extérieure en écartant un rideau bleu, galerie d’où l’on peut voir, et détailler inlassablement, assis avec le Chat dans sa chaise longue, le jardin jonché de vieilles batteries à moitié enterrées, de pneus pourris et de fûts à gas-oil rongés par la rouille, et au-delà, tout au fond sous les arbres, le cheval, présence inquiète et inquiétante, dégageant une aura épaisse, faite d’une odeur forte et de chaleur, à laquelle ne sont pas étrangères l’herbe mâchée et le crottin frais. Par la fenêtre opposée à la galerie — et tout au long de ma lecture, j’ai remâché le plan suivant lequel je pourrais schématiser sur le papier cette minutieuse topographie sans parvenir à une solution définitive, bien qu’elle soit inlassablement décrite sous toutes les coutures — le Chat a vue sur la plage où somnole et patrouille le maître nageur, ancien champion provincial de la plus longue immersion dans l’eau (campeón provincial de permanencia en el agua), vue aussi sur la rivière, lisse, dorée, sans une seule ride, vue sur l’île basse enfin, poussiéreuse, en pente douce vers l’eau qui ronge sa rive d’où surgit un matin le Bancal sur son cheval pour traverser la rivière à gué, et les jours suivants, à bord d’une barque pour livrer à celui-ci du foin chez son hôte, deux bottes dont le transport lui donne cet air de marionnette obstinée (empecenida) dans sa marche. Non seulement l’intrigue est secondaire, mais son exposition est condensée, ramassée en une dizaine de pages qui nous énumèrent au mitan du récit les différents meurtres inexpliqués de chevaux appartenant à tel ou tel vivant ici ou là, les hypothèses circulant parmi la population locale, et les mesures prises par le commissaire, surnommé justement el Caballo, par ailleurs notoirement adepte des arrestations arbitraires et des interrogatoires musclés, soit des méthodes qui font directement écho à la dictature militaire, ce qui fait dire à l’éditeur en quatrième de couverture que Saer « évoque métaphoriquement la dictature », quand au contraire aucune clé de lecture, aucun sous-texte ne m’apparaît dans cet ingrédient d’atmosphère d’autant moins métaphorique que les bavures du Caballo sont décrites explicitement. L’intrigue est si secondaire et condensée qu’elle apparaît comme un simple motif sans durée, comme si les événements de l’Histoire n’avaient rien à voir avec le Temps qui s’étire dans tous les sens autour d’eux, qui les dissout dans sa léthargie ; le temps vécu de l’expérience phénoménologique, où se chevauchent aléatoirement les souvenirs, les rêves, les gestes, le discours et les sensations, où tour à tour se disputent l’occupation de l’espace mental : l’affaire des chevaux, les aiguilles incandescentes de la canicule, le vin blanc et le stock de glaçons fondant dans un bol, la matière épaisse et dense de l’air, les ébats toniques d’Elisa et le Chat à l’issue desquels ils ne sont pourtant, comme on dit, pas plus avancés, la couleur caramel de la rivière et le sillage que la barque du Bancal y inscrit, le jus de viande gouttant d’une barbe, les cris et le ballon des enfants sur la plage, une voiture garée de nuit dans la rue et ses occupants dont on se représente encore le va-et-vient après que tout signe de leur présence s’est évanoui, une lecture critique de La Philosophie dans le boudoir (ennui de l’orgie), dont Pigeon a envoyé un exemplaire au Chat depuis la France, la bande dessinée du maître nageur, l’ambiance poisseuse en ville, les bottes de foin, les vielles batteries à moitié enterrées, les pneus pourris et les fûts à gas-oil rongés par la rouille… Un temps qui pointe sa flèche dans les deux sens, d’arrière en avant et d’avant en arrière, qui bégaie parfois mot à mot d’un paragraphe à l’autre, avec ou sans d’infimes variations (j’ai trouvé il y a peu une tentative bien moins convaincante de recourir à ce procédé dans Même les morts, de Juan Gómez Bárcena, avec la répétition de loin en loin d’une poignée de phrases triées sur le volet que l’auteur s’efforce de placer opportunément, comme un panneau de signalisation clignotant pour dire « attention, passage important ! », de sorte que, agacé, j’ai fini par survoler les répétitions dès que je les repérais, tandis que chez Saer je les ai relues minutieusement), un temps lancinant infiniment fractionné en arrêts sur images dont la haute fréquence approche le continu : comment ne pas y voir l’incursion de Saer dans la veine du Nouveau roman, lui qui se faisait fort de toucher à tous les genres, sans trahir néanmoins la suprême clarté de son style ni son art d’étayer la narration (dernière qualité qui l’apparenterait peut-être, même lointainement, au Conrad de Nostromo), opposant son piétinement circulaire aux vibrations stochastiques de Claude Simon, mais accouchant comme lui d’un temps non calculable : « ce laps de temps non calculable, aussi large que long est le temps tout entier, qui avait paru vouloir, à sa manière, persister, s’enfonce, paradoxal, à la fois dans le passé et dans l’avenir et naufrage, comme le reste, ou en l’entraînant avec lui, indicible, dans le néant universel. »
“el lapso incalculable, tan ancho como largo es el tiempo entero, que hubiese parecido querer, a su manera, persistir, se hunde, al mismo tiempo, paradójico, en el pasado y en el futuro, y naufraga, como el resto, o arrastrándolo consigo, inenarrable, en la nada universal.”
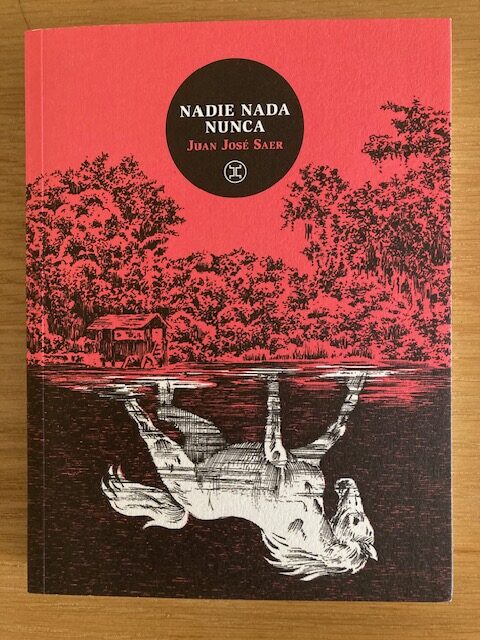
Last modified: 16 novembre 2025