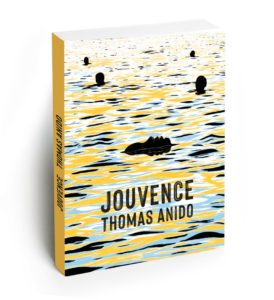M’intéressant actuellement à la tradition intellectuelle du libéralisme économique, ce grand méchant loup, je regarde la série documentaire Free to Choose réalisée par Milton Friedman en 1980. Chaque épisode est découpé en deux parties d’environ trente minutes : d’abord une séquence reportage où Milton Friedman, filmé face caméra dans différents environnements — des ateliers de confection à Hong-Kong, un métier à tisser traditionnel en Inde, des manufactures modernes au Japon, des logements sociaux en Angleterre, les anciens locaux de la Bank of United States, célèbre pour sa faillite retentissante en 1931, la maison de Thomas Jefferson, une école du Bronx etc. —, illustre un point spécifique de sa doctrine à partir de son interprétation de l’histoire et des politiques économiques, après quoi vient un débat où il est confronté à des économistes (on y croise entre autres Thomas Sowell), des businessmen, des hommes politiques (Donald Rumsfeld fait une apparition), des syndicalistes et des journalistes qui discutent de ses idées.
Outre le charisme naturel du personnage — sourire avenant, timbre plaisant, diction limpide et assurée, franchise à toute épreuve ; le genre de professeur qui, sans doute possible, devait faire forte impression, qu’on souscrive à ses thèses ou non —, ce qui me frappe, c’est l’intransigeance et la radicalité de sa conviction libérale (d’aucuns y adjoindront le préfixe ultra, d’autres néo), quels que soient les arguments, parfois excellents, que lui opposent ses contradicteurs (il a comme un roulement d’épaules, et remet ses lunettes en place, dès qu’il est mis en difficulté). Aux usines à gaz alambiquées du welfare state qui voue son génie bureaucratique à l’échafaudage de mécanismes redistributifs censés ménager à tout prix la chèvre — la liberté — et le chou — l’égalité —, il oppose invariablement un principe d’une extrême simplicité : état minimal cantonné au régalien dans ce qu’il a de plus sommaire, comme garant du framework légal à partir duquel peut se déployer sans entraves la libre concurrence, et absolue liberté d’entreprendre comme de jouir du fruit de son travail.
Pour la gauche ultra-planificatrice, c’est le comble du cynisme, la loi d’une jungle de cauchemar, où les puissants écrasent ouvertement les faibles tout en s’abreuvant de leur sang : c’est que, peu charitable par nature, elle n’envisage pas une seconde que son adversaire aussi puisse être animé de ces bonnes intentions dont elle s’arroge un peu vite le monopole (de même qu’elle nie impunément la conversion desdites bonnes intentions en désastres dans la pratique). Milton Friedman n’avait pourtant rien du diable : à sa façon, qui prenait certes pour ultime étalon la possibilité pour l’individu de s’enrichir (un travers d’économiste de droite, dira-t-on, mais la corrélation d’un tel critère avec l’amélioration générale des conditions de vie est-elle nulle pour autant ?), il aspirait lui aussi à une société meilleure, à la condition qu’on considère celle-ci non pas comme un super-organisme auquel toutes ses parties sont solidairement subordonnées mais plutôt comme un ensemble, au sens quasi-mathématique du terme : une collection d’individus, une multitude qui, secondairement seulement, forme un tout. Faire reculer la pauvreté, plaidait-il, est moins impossible que de l’éradiquer, et pour y parvenir, le meilleur moyen corroboré par l’expérience, c’est le marché. Quoi qu’on en pense, coupons court au mauvais procès : sa proposition d’un impôt négatif (qui se distingue du salaire universel par la condition d’un seuil de revenu) prouve bien qu’il n’était pas question pour lui de laisser tout bonnement crever les pauvres, même s’il envisageait peut-être cette mesure comme un mal nécessaire, une transition vers l’idéal-sans-aide-sociale (c’est ce qu’il semble dire, au détour d’une phrase, dans l’un des épisodes), auquel cas il était plus perméable qu’il ne le prétendait au fantasme utopique d’une humanité délivrée pour toujours de l’indigence.

Naïveté simpliste sans doute, ou aveuglement coupable, la croyance monomaniaque — typique du théoricien — en un principe unique capable à lui seul d’ordonner le monde, quand bien même ce principe unique, décentralisateur par excellence, prendrait justement acte de l’impuissance humaine à régir en surplomb le pullulement des causes et des effets, laissant ainsi libre cours aux forces impersonnelles du marché ; croyance qui l’aura conduit à se fourvoyer auprès d’un Pinochet (rendons-lui cela dit justice de ne l’avoir que brièvement rencontré en 1975, sans avoir jamais été son conseiller, mais convenons aussi que c’était déjà une complaisance de trop), convaincu que de la liberté économique devait inexorablement découler un jour la liberté politique ; il se trouve qu’au Chili, c’est bien ce qui a fini par arriver, oui, mais à quel prix ? Aussi ouvert soit-on à l’éventualité que, dans une certaine mesure et sur le papier, son principe unique soit le bon, on a par exemple du mal à se convaincre que, au cas où l’enseignement primaire et secondaire seraient eux aussi soumis à la loi du marché, comme il le préconise, les effets pervers n’en excéderaient pas allègrement les bienfaits. La prévention comme innée qu’on éprouve à l’encontre de telles réformes, peut-elle vraiment n’être rien de plus que l’effet d’un conditionnement par l’usage ? Et cet âge d’or de la fin du XIXe siècle auquel il aime à se référer, et que d’autres tiennent au contraire pour un regrettable Far West, n’était-ce pas juste une étape de l’Histoire qui ne reviendra pas sur ses pas ; un passage révolu que jamais plus elle n’empruntera ?
Quel contraste en tout cas entre le modèle dépouillé promu par Friedman et les proportions toujours plus léviathanesques que prend l’État depuis lors… (Bien sûr je vois le problème par la lorgnette française, parangon d’état-nounou caritatif, quand Milton Friedman s’intéressait avant tout aux États-Unis, un tout autre monde à cet égard, mais non exempt selon lui de vices rédhibitoires à l’époque déjà, et qui n’ont sans doute cessé de s’approfondir depuis, témoin les fameux tarifs ; puisque la pente naturelle de l’État, c’est l’enflure.) Quel contraste, donc, avec, pêle-mêle : l’escalade taxatrice à laquelle nos députés, toutes tendances confondues, se livrent actuellement avec délices, le bonus réparation subventionnant le raccommodage de nos chaussettes, la RGPD qui nous harcèle de ses bannières où qu’on aille en ligne, le Diagnostic de Performance Énergétique et l’encadrement des loyers qui assèchent ensemble l’offre locative, le fléchage des tickets-resto, la monnaie de singe du pass culture venant grossir les ventes de mangas best-sellers qui n’avaient pourtant pas besoin de ça pour s’écouler par millions, la subvention népotique de navets sans spectateurs, les comités Théodule du Haut-commissariat au plan et de dizaines d’autres agences superflues, les cotisations retraites astronomiques directement mises sur compte épargne par les boomers les plus favorisés, la propagande agressive à temps plein des chaînes publiques, les plans banlieue et le financement des salles de shoot, la prise en charge des nuits d’hôtel de Mineurs Non Accompagnés qui font vingt-cinq ans à vue d’oeil ; bref la parthénogenèse exponentielle de tributs, d’aides, de normes, de prescriptions, de contrôles, de tracasseries et de couches administratives avec, cerise sur le gâteau, l’arbitraire technocratique des directives européennes qui chapeautent le tout depuis des hauteurs inaccessibles à l’entendement, comme s’il nous fallait encore un super-état par-dessus le premier — comme s’il nous fallait des états en cascade à tous les niveaux pour nous enceindre de leur suspecte sollicitude from cradle to grave.
Alors oui, l’attachement viscéral de Milton Friedman à la liberté individuelle nous paraît tout à coup salutaire.
« The society that puts equality before freedom will end up with neither. The society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both. »

Last modified: 30 novembre 2025