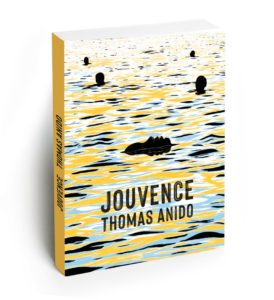Lisant Niels Bohr et la physique quantique, un ouvrage de vulgarisation écrit par le physicien François Lurçat (mort en 2012, et dont la fiche Wikipédia m’apprend qu’il a momentanément soutenu le maoïsme dans les années 70, et je me demande ce que tous ces gens intelligents pouvaient bien trouver à Mao, mais je m’égare…), je repense à un autre livre, de philosophie cette fois, lu quelques années auparavant, qui m’avait alors impressionné par sa virtuosité conceptuelle et l’acuité de son diagnostic au sujet, disons, de la révolution technicienne du 20e siècle, un livre dont la lecture m’avait coûté bien des efforts : Approche de la criticité, de Jean Vioulac. Je me suis souvenu, en lisant Niels Bohr et la physique quantique, que Vioulac formulait certaines thèses frappantes relatives justement aux conséquences de l’émergence du paradigme quantique, sous la houlette de Bohr, Heisenberg, Schrödinger et consorts.
L’atome selon Bohr
Fort de ses travaux sur l’atome dans un contexte scientifique où différentes découvertes expérimentales mettent à mal l’édifice de la physique classique, c’est Niels Bohr (1885-1962) qui suggère le premier qu’une « description spatio-temporelle classique de l’interaction entre matière et rayonnement est impossible »[1] puis élabore l’interprétation désormais bien connue, quoique toujours aussi difficile à concevoir pour nos esprits pétris de perception causale, de ce phénomène (phénomène non plus en tant qu’objet empirique de l’intuition, comme depuis Kant, mais en tant qu’interaction entre l’objet et l’instrument qui le mesure) : à l’échelle atomique, les objets physiques revêtent alternativement la forme d’ondes ou de corpuscules, en fonction du dispositif mis en place pour les déceler. On ne peut pas, par exemple, déterminer à la fois la vitesse et la position d’un photon : c’est l’un ou l’autre.

Devant des physiciens réunis à Côme le 16 septembre 1927, Bohr présente un rapport intitulé Le postulat quantique et le dernier développement de la théorie atomique, où il exprime « l’essence » de sa théorie : « tout processus atomique présente un caractère de discontinuité, ou plutôt d’individualité, complètement étranger aux théories classiques », ce qui « nous oblige à renoncer à une description à la fois causale et spatio-temporelle des phénomènes atomiques. Car dans notre description ordinaire des phénomènes naturels, nous admettions en dernière analyse que l’observation d’un phénomène ne lui causait aucune perturbation essentielle. […] Le postulat quantique […] exprime que toute observation des phénomènes atomiques entraîne une interaction finie avec l’instrument d’observation : on ne peut par conséquent attribuer ni aux phénomènes ni à l’instrument d’observation une réalité physique autonome au sens ordinaire du mot. »[2]
Bien sûr, Bohr n’a pas forgé seul la théorie quantique tel que nous la connaissons aujourd’hui : celle-ci est née d’un bouillonnement intellectuel auquel ont contribué tous les grands physiciens de sa génération (Heisenberg, Schrödinger, Planck, de Broglie etc.). Elle a d’ailleurs trouvé en la personne d’Einstein son plus farouche — et fécond — contradicteur : aussi paradoxal que cela puisse paraître s’agissant du père de la théorie de la relativité, qui n’avait donc pas hésité à porter le premier coup fatal au caractère apparemment absolu de l’espace et du temps, celui-ci ne pouvait se résoudre à la théorie quantique formulée par Bohr : « Cette croyance est logiquement possible sans contradiction, mais elle est si contraire à mon instinct scientifique que je ne puis abandonner la recherche d’un système plus complet de concepts »[3], écrit-il dans un article en 1936.
À cette théorie, Bohr a donné une expression singulière, cherchant un équilibre entre le rejet (presque un déni ?) manifesté par Einstein et le formalisme abstrait du platonicien Heisenberg (selon qui la nature « imite un schéma mathématique »[4]), qui n’éprouva pas pour sa part de scrupule à congédier, via sa mécanique matricielle, toute intelligibilité sensible (faut-il alors voir un lien entre son approche déshumanisée de la science et son concours à la propagande nazie, voire l’intention, que certains historiens lui prêtent bien qu’il ne l’ait jamais concrétisée, de concevoir la bombe atomique au service d’Hitler ?). C’est que, selon Bohr et contrairement à Heisenberg, la physique quantique ne disqualifie pas la physique classique, dont l’ontologie géométrique et spatio-temporelle conserve sa validité par la concordance qu’elle entretient avec notre perception naturelle du monde réel : en affirmant plutôt qu’elle « apporte une limitation essentielle aux concepts de la physique classique dans leur application aux phénomènes atomiques »[5], il en circonscrit avec précaution la portée au seul domaine qu’elle concerne, soit l’exploration scientifique des régions atomique et subatomique, dont l’explicitation conceptuelle, pour se rendre accessible à notre entendement fondé sur le langage et la géométrie, et non pas sur la seule abstraction mathématique, ne peut se passer de recourir aux catégories de la physique classique.
L’adieu au bon sens
Or, à en croire l’étude minutieusement documentée menée par Jean Vioulac dans la partie de son livre intitulée Crise de la physique et révolution technologique, et contrairement à l’esprit de nuance préconisé par Niels Bohr, le paradigme quantique aurait bel et bien supplanté sans remède, en le rendant obsolète, le vieux paradigme galiléen. D’ailleurs, pour aussi souvent qu’y soit cité Niels Bohr, nulle part n’est fait mention de sa mise en garde contre une généralisation trop littérale du paradigme quantique, suivant un diagnostic radical qui entérine plutôt la vision d’Heisenberg, d’après qui nous aurions atteint « un état de la connaissance où l’objectivation de la nature n’est plus possible »[6], ce qui mène Vioulac à formuler sans appel son verdict : « C’est donc le cadre même de l’épistémologie classique, celui de la constitution de tout phénomène comme objet, qui doit être abandonné »[7].
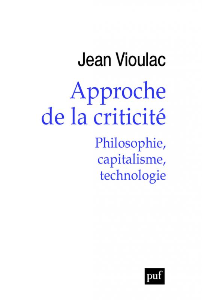
Aussi pertinente que soit l’analyse proposée par Vioulac du basculement quantique, qu’il identifie comme avènement d’une phénoménotechnique (Bachelard), le bon sens s’insurge contre la portée générale qu’il accorde à l’événement, quand il écrit, par exemple, que « en disqualifiant toute intuition subjective, la physique quantique renvoie ainsi tout vécu dans le monde — la matière telle que je la touche, les formes et les couleurs telles que je les vois, le vécu même de mon corps — au rang d’apparitions sensibles dépourvues de toute consistance ontologique »[8]. En quoi les mystères de l’infiniment petit devraient-ils rendre caduque ma perception à hauteur d’homme ? Ne sont-ce pas plutôt les atomes qui sont dépourvus de toute consistance ontologique ? Ne sont-ils pas au fond, du fait justement qu’on ne peut les appréhender qu’à travers l’appareillage expérimental et mathématique, bien moins réels que les doigts de ma main, que l’écorce d’un arbre et le vent dans ses branches ? Il y aurait là comme une extrapolation abusive, peut-être même un délire métaphysique, comme Schrödinger lui-même le suggère, moins crûment certes, au cours d’une série de conférences tenues à Dublin en 1950 : « Je ne peux pas croire que l’enquête philosophique profonde sur la relation entre le sujet et l’objet et sur la vraie signification de la distinction entre sujet et objet dépende des résultats quantitatifs de mesures physiques et chimiques effectuées avec des balances, des spectroscopes, des microscopes, des télescopes, des compteurs de Geiger-Müller, des chambres de Wilson, des plaques photographiques, des dispositifs pour mesurer la perte de radioactivité et que sais-je encore. »[9]
Mais c’est sans doute qu’il n’est déjà plus question ni d’enquête philosophique, ni de mon pauvre bon sens qui me fait voir le réel à hauteur d’homme, tous deux dépassés depuis que le dispositif technique de mesure et de calcul, alors cantonné à la région ultra localisée des atomes, a déployé sa tentaculaire machinerie informatique pour objectiver toutes les dimensions de la vie humaine : notre collecte de data et nos algorithmes sont pour nous ce qu’étaient pour les particules élémentaires les instruments de mesure énumérés par Schrödinger et la mécanique matricielle d’Heisenberg.
À l’arrêt de bus
Et tout à coup, le bon sens lui-même, la perception la plus triviale s’en trouvent altérés en profondeur sans même qu’on s’en rende compte. Je m’en suis fait la remarque à l’arrêt de bus. Ma façon d’éprouver le temps n’est-elle pas tout autre du simple fait qu’entre le bus à venir et moi s’interpose une application mobile qui m’informe en temps réel de l’attente qu’il me reste ? Sans ce dispositif, j’attends un bus, qui mettra plus ou moins longtemps à arriver. Au pire, au bout d’un moment, si l’attente est trop longue, je peux m’impatienter, je peux même me demander s’il ne s’est pas produit quelque incident sur la ligne. Je regarde l’heure, et je peste. En revanche, par l’entremise de ce dispositif, je sais d’avance quand j’aurai mon bus. Quand je sors du métro, dont la station se trouve à une certaine distance de l’arrêt de bus, je jette un coup d’œil à l’appli. Si celle-ci m’indique qu’il me reste moins de trois minutes avant le passage du prochain bus, je sais que je ne l’aurai pas, et pour peu qu’elle m’indique également que le suivant arrivera vingt minutes plus tard, me voilà dépité d’avance, quelque chose est gâché, je vais rentrer tard et je le sais. Si elle m’indique trois-quatre minutes, alors je peux l’avoir, mais je dois courir, et voilà que, zigzagant parmi les usagers, j’entame un sprint dans le tunnel piéton qui me mène jusqu’à l’avenue. Si l’appli m’indique cinq minutes ou un peu plus, c’est le meilleur cas de figure, je peux marcher tranquillement, et une fois arrivé à l’arrêt de bus, je n’aurai que peu d’attente. Si le bus est bloqué dans la circulation, les minutes de l’application s’étirent : il y a tromperie, la machine ment, c’est un scandale ! Avec le dispositif nait l’exigence d’efficacité qui alimente le rêve d’un flux optimal au sein duquel je me coulerais sans anicroche ni temps mort (et je repense — c’était dans une autre vie — aux routes andines, et aux autochtones fatalistes, chargés de poules et de patates, assis imperturbables dans la poussière, au milieu de nulle part : l’autocar promis, dont dépendait pourtant leur commerce, autant dire leur vie, pouvait tout aussi bien passer dans dix minutes ou cinq heures — à quoi leur aurait servi l’appli ? mais peut-être cela a-t-il bien changé depuis, là-bas aussi). D’ailleurs, quand j’estime la durée totale de mon trajet, je ne considère pas la moyenne des durées possibles constatées d’expérience, mais le temps record le plus court dont je voudrais qu’il soit la norme. Avec ou sans appli, l’impondérable est toujours possible, mais avec, il est connu d’avance, ce qui influe sur mon comportement. La nuance est ténue certes, et je ne dis pas que son effet est forcément négatif : la preuve, sachant que le prochain bus mettra trop longtemps à arriver, je peux décider de rentrer à pied. L’occasion de flâner (quoique je marche d’un bon pas, j’ai tout de même une certaine distance à couvrir).
Le piéton désormais compte ses pas, le joggeur calcule les calories qu’il brûle. Il n’y va pas que du culte de la performance : c’est un dispositif général d’évaluation et de mesure qui est en jeu. Comme si n’avait plus d’incidence réelle tout ce qui n’est pas traduit en données par l’instrument. La compilation de ces données, insensées en soi, nous empêche-t-elle pourtant, collectivement, d’être toujours plus obèses ?
Ces exemples d’usages individuels restent anecdotiques, direz-vous, mais d’autres abondent à très grande échelle, témoignant du fait qu’entre notre vécu dans le monde et la perception que nous en avons s’interpose désormais à tout moment un dispositif technique qui fait écran — à commencer par la télé, pionnière du genre mais aujourd’hui en état de ringardisation avancée, et bien-sûr Internet, devenu cette « sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part » que nous portons à chaque instant au creux de la paume.
Objectivation du flou
Nous avons depuis deux ans sous les yeux une illustration particulièrement frappante de cette idée, par l’analogie directe qu’elle me semble autoriser avec certaines caractéristiques du paradigme quantique. Comme l’atome, le virus ressort de l’infiniment petit (concédons que le virus est tout de même plus grand : de l’ordre de 10-8m par rapport au 10-10m du rayon de l’atome, d’après Wikipédia…), et si des appareillages extrêmement pointus (la microscopie électronique, par exemple) permettent éventuellement de l’isoler, encore qu’ils n’en produisent pas des images véritablement photographiques, mais bien plutôt des reconstitutions informatiques, son être ne nous échappe pas moins que celui de l’atome. Si c’est notre bonne vieille structure spatio-temporelle que défie crânement l’atome, dans le cas du virus, et plus particulièrement du covid, ce sont ses dynamiques de circulation qui mettent tous nos modèles de prévision en échec, eu égard à l’extrême versatilité des innombrables facteurs jouant en interdépendance (variables sociales, démographiques, climatiques, virologiques, immunologiques, génétiques etc.), comme nos éminents vaticinateurs médiatiques en font chaque jour l’amère expérience, quoiqu’ils ne se sentent jamais tenus de faire amende honorable. Ces deux régions insaisissables ont donc en commun qu’il y règne un grand flou probabiliste, selon des modalités bien spécifiques à chacune.
Pour objectiver l’insaisissable, il nous faut donc matérialiser sa présence parmi nous, et la rendre universelle, via la médiation du dispositif technique. Qui s’inquiéterait d’entendre renifler des bambins à l’école élémentaire, habitués à échanger entre eux tous types de virus hivernaux, si n’était rendue visible à tout instant la menace du covid par les masques qu’on leur impose de porter ? Qui vivrait dans la terreur d’être atteint à son tour par une maladie bénigne pour l’écrasante majorité, si n’étaient annoncés chaque jour avec tambour et trompette des centaines de milliers de cas positifs, et ainsi entretenue l’idée d’un mal omniprésent ? Qui s’acharnerait à vouloir convertir à un vaccin imparfait une inoffensive minorité de récalcitrants, décrétés boucs-émissaires pour leur propre bien, si n’était fantasmé l’espoir d’un salut collectif commandant la soumission unanime et sans condition à la panacée du dispositif ? Qui porterait des masques à l’extérieur, qui irait se faire tester avant d’avoir manifesté le moindre symptôme, si ce n’était par pure fidélité au dispositif ? Des fois que, pauvres fous, nous vivions dans l’insouciance de la maladie, ou du moins pas plus soucieux d’elle que des mille calamités dont la vie peut nous accabler n’importe quand, le triptyque masque-test-vaccin est là, saturant d’injonctions l’espace public, pour nous rappeler à l’ordre.
Littératures protocolaires
Partout, tout le temps, ça dispositive à plein tube : nous sommes câblés ainsi, désormais. L’autre jour — passons donc du coq à l’âne — j’ai lu quelque part cette citation d’un certain Pascal Mougin, apparemment spécialiste de littérature et d’art contemporains : « l’écrivain conceptuel serait celui qui subordonne son texte à un protocole préalablement conçu, à savoir une règle ou un défi plus ou moins arbitraire, improbable ou gratuit, dont le but est d’être réalisé et de donner lieu à un compte-rendu. » Mon premier réflexe fut de penser : tout geste littéraire, tout roman ou poème n’est-il pas un défi arbitraire et gratuit, ne serait-ce que de l’écrivain à lui-même ? On pourrait objecter à cet aspect de la définition qu’il est bien vague, creux car malléable à souhait, même si l’on sent bien que sont visés les jeux sous contrainte à la manière oulipienne. En réalité, les mots qui comptent ici sont « conceptuel », « protocole » et « compte-rendu », en ce qu’ils confèrent indéniablement son (pompeux) cachet contemporain (oserais-je dire quantique ?) à l’ensemble (mais peut-être cédé-je ici au procès d’intention, car je ne connais rien du contexte dont est extraite cette citation…). Nous y revoilà : l’avenir de la littérature appartiendrait aux ingénieurs et aux laborantins — aux techniciens qui, à l’instar des physiciens, bricolent entre initiés, hermétiquement, leurs protocoles. Les protocoles informatiques — littérature générative, algorithmique, hypertextuelle etc. — sont devenus le moyen privilégié pour des écrivains reclus malgré eux dans la confidentialité d’incarner l’avant-garde minoritaire contre l’ogre mainstream de la littérature industrielle qui recycle indéfiniment les mêmes recettes et monopolise l’intégralité du champ.
Point n’est besoin d’ailleurs de recourir à des dispositifs techniques trop sophistiqués. J’ai notamment l’impression de voir proliférer (ou m’exagérerais-je le phénomène ?) le genre du journal en ligne qui, s’il n’a rien de neuf dans son principe de journal, se distingue de son ancêtre par sa diffusion immédiate (ou quasi-immédiate). Aussitôt écrit, aussitôt lu (ou du moins donné à lire) : voilà le protocole mis en œuvre par l’écrivain en temps réel qui doit logiquement, sans cesse et sans fin, rendre compte de l’écrire-en-action, faisant la part belle aux états d’âmes et atermoiements méta qui l’absorbent tandis qu’il élabore son œuvre (jusqu’à enregistrer à voix haute, pour les faire entendre à son audience, les commentaires qui lui viennent à l’esprit devant sa table de travail — ça s’est vu), suivant en cela un impératif de transparence (feinte ou sincère…) que ne renierait pas l’époque. Comme si l’autre pôle du pacte en tension entre auteur et lecteur, le lire, était devenu une perspective accessoire. Et je me suis demandé, au sujet des auteurs du passé que j’affectionne : s’ils m’étaient contemporains, aurais-je vraiment envie de lire chaque jour en direct leurs commentaires immédiats sur leur propre écriture en train de se faire ? Rien n’est moins sûr…
Tandis que ces idées me travaillaient, sans que je fusse bien sûr de leur clarté ni de leur justesse (ne seraient-elles pas l’expression belliqueuse de ma position minoritaire au sein même de la minorité ?), je terminais les Scènes de la vie d’un faune, d’Arno Schmidt, qui me laissaient une impression mitigée, parce que c’est un livre déroutant, difficile à suivre, mais dont on ne peut nier la formidable liberté de style ni l’anticonformisme forcené ; dans l’édition que j’ai empruntée à la médiathèque (traduction de Nicolas Taubes pour Tristram), il y a une courte postface de Stéphane Zékian qui rend tout à fait justice au livre, proposant une lecture convaincante de sa structure atomisée, dont on comprend qu’elle est tout sauf gratuite, justement. Il y écrit par ailleurs : « L’histoire littéraire n’est pas une course de fond — ce que ne comprendront jamais les horlogers du milieu qui décrètent l’heure comme on promulgue un règlement. Schmidt ne joue pas ce jeu. Il écrit ailleurs. Les hochets de l’avant-garderie ne l’amusent pas. »
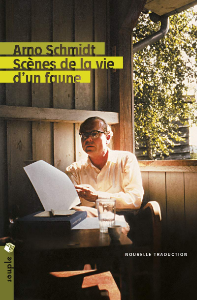
C’est tout le problème des avant-gardes, qui voient le développement des tendances esthétiques comme une histoire linéaire et cumulative, dont la pointe avancée est toujours l’aboutissement et donc le dépassement de tout ce qui l’a précédée : on n’aurait jamais le droit de revenir en arrière ni d’aller et venir dans n’importe quel sens. C’est d’ailleurs un état d’esprit similaire qui a conduit la philosophie continentale, toujours avide de nouvelles prouesses, à la surenchère dans le charabia. Je crains que dans le cas de la littérature, cela ne la condamne plutôt à l’égotisme sans pour autant la mettre à l’abri du conformisme, emmurée dans l’entre-soi conceptuel du dispositif.
Last modified: 4 février 2022