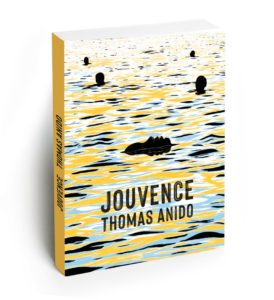Curieux livre d’Henri Lefebvre, dont je m’étais promis de lire quelque chose depuis longtemps. Quand, comme j’ai l’habitude de le faire pour presque chacune de mes lectures, j’ai posté sa couv’ sur mon fil Twitter, 14 personnes l’ont « likée » et 4 l’ont « retweetée », dont deux qui ont ajouté un commentaire, du type poing levé et couteau entre les dents (bizarrement, pour une raison que j’ignore, je n’arrive plus à afficher lesdits commentaires, à l’heure où j’entame cette note. Leurs auteurs se seraient-ils rétractés depuis ?), statistiques qui disent un peu, à la modeste échelle de mon audience et toutes pincettes prises quant à leur très réduite représentativité, l’estime où est tenue cet auteur parmi un certain public (lequel, de public ? Sans doute un public un minimum averti en matière de marxisme, dont Lefebvre fut un éminent spécialiste).
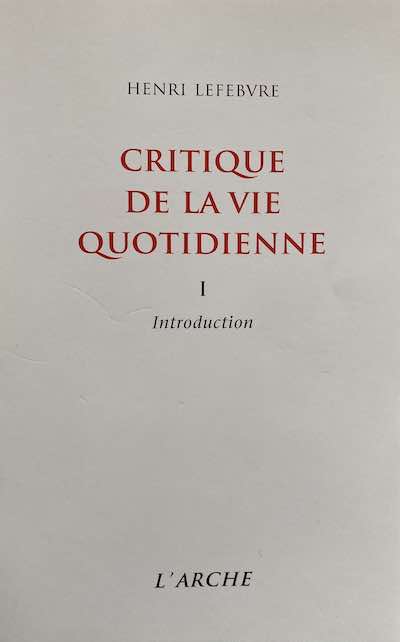
Il s’agit d’une deuxième édition (impeccable, proposée par l’Arche — et pour la petite histoire, la librairie très mainstream où j’ai commandé le livre a exigé que je vienne payer mon exemplaire d’avance pour se prémunir contre toute défection de ma part, au motif que l’Arche serait réputée pour ne pas prendre de retours, demande qui m’a scandalisé — moi, faire défaut à un engagement que j’avais pris ? — j’ai même failli annuler ma commande, et puis, bonne poire, je me suis finalement contenté de râler lors de mon passage en caisse, ce qui n’a pas suffi à convaincre l’employé de l’outrecuidance du procédé ; mais ils ne recevront pas de sitôt d’autre commande de ma part, qu’on se le dise, même si ça ne leur fait qu’une belle jambe) précédée d’un long avant-propos (avant-propos d’une introduction, donc) qui couvre presque la moitié du volume, et m’a paru un tantinet fourre-tout, le genre d’avant-propos qu’on devrait plutôt lire après le propos et qui, dix ans plus tard, consiste en une actualisation ou une révision du, ou plutôt même en un complément au, propos, justement, du livre initialement paru en 1947. Il y est question, en vrac, du progrès des « arts ménagers » (et du conséquent impact de la technique sur la vie quotidienne), de Chaplin et de Brecht, de l’avènement en cours de la société du loisir (comme rupture factice avec la quotidienneté du travail), du nivellement mondial des aspirations de l’individu moyen (malgré le fossé séparant à l’époque le développement de l’Ouest capitaliste de celui de l’Est communiste), de la misère de la philosophie (« Qui donc n’aspire pas à dire son mot sur les “grands problèmes” ? »), et du mauvais accueil fait au livre, notamment par les marxistes, à sa parution (du fait d’un « préjugé défavorable à la sociologie »). Entre autres.
Le projet de Lefebvre, c’est d’étendre la méthode du matérialisme dialectique — selon laquelle les conditions d’existence des hommes déterminent leur conscience (et non pas l’inverse comme le voudrait candidement la métaphysique idéaliste), méthode inaugurée et appliquée par Marx à l’analyse du capital, du travail et de la production — à l’intégralité de la vie quotidienne, aux faits et gestes les plus banals, pour débusquer l’aliénation qui désormais se niche dans chaque instant de la vie des hommes, y compris et en particulier dans les moments privés censés y échapper, supposément étrangers à la sphère productive : « Je la surprends, “l’aliénation”, dans la romance que je chante, dans le vers que je récite, dans le billet de banque que je manipule et dans la boutique où je vais entrer, sur l’affiche que je lis, comme entre les lignes de ce journal. Je la surprends dans ce mouvement qui dépossède l’humain au moment précis où on le définit par la possession. Je saisis comment l’aliénation substitue une fausse grandeur à la faiblesse de l’homme, et une fausse faiblesse, à sa véritable grandeur. J’attrape au vol, pour ainsi dire, les mots grandiloquents, les abstractions, les déductions, tout ce qui vaporise diaboliquement la volonté et la pensée de l’homme. »
(Ainsi par exemple du loisir, dans une veine où l’on repère une source d’inspiration commune à Debord et Baudrillard : « Le loisir apparaît ainsi comme le non-quotidien dans le quotidien. On ne peut sortir du quotidien. Le merveilleux ne se maintient que dans la fiction et l’illusion consentie. Il n’y a pas d’évasion. Cependant, l’on désire avoir aussi proche que possible — à portée de la main si possible — l’illusion de l’évasion. Illusion qui ne sera pas entièrement illusoire, mais constituera un “monde” à la fois apparent et réel – réalité de l’apparence et apparence du réel — autre que la quotidienneté et cependant aussi largement ouvert et aussi inséré en elle que possible. On travaille ainsi pour gagner des loisirs, et le loisir n’a qu’un sens : sortir du travail. Cercle infernal. »)
Le livre se présente alors comme une esquisse, ou l’annonce d’un programme à venir : « s’efforcer de reconstituer la vie réelle d’un certain nombre d’individus (en comparant la vie réelle avec la conscience de la vie, avec l’interprétation de la vie) » ou encore confronter « la vie humaine effective avec ses “expressions” : morale, psychologie, philosophie, religion, littérature ». De sociologie, au sens d’une étude systématique et documentée de certains faits sociaux afin d’en induire des modèles théoriques, il sera en fait peu question dans ce premier volume, et de ce fait, on se demande presque en quel honneur le livre aurait pu écoper d’un préjugé défavorable à la sociologie, sauf à considérer peut-être l’étude du quotidien, donc de l’anecdotique, comme caractéristique de celle-ci, par opposition à la philosophie, naturellement vouée à des sphères plus aériennes. Ce serait alors, de la part du sociologue, comme un gage (coquet) de (fausse) modestie.
C’est en tout cas dans un style volontiers assertif que Lefebvre entend nous convaincre que seule la méthode dialectique, en tant qu’elle est démystificatrice, est à même de mener à bien ce programme. Et le premier agent de la mystification auquel il s’attaque n’est autre que la littérature qui, depuis le 19e siècle, au travers des œuvres d’une brochette de génies arbitrairement choisis, s’ingénierait à dénigrer le quotidien : « Sous le signe du Merveilleux, la littérature du XIXe siècle mène contre la vie quotidienne une attaque qui n’a pas faibli. Elle s’efforce de la dégrader, de la discréditer. » Baudelaire (« confusion mentale organisée »), Flaubert (« le petit bourgeois qui haïssait les petits bourgeois »), Rimbaud (« névrose entretenue »), puis les surréalistes au 20e siècle (« succédané du romantisme ») en prennent pour leur grade au pas de charge, suivant une grille de lecture psychologisante et violemment réductrice : dérégler le quotidien par la poésie, fût-ce pour le sublimer, c’est encore l’escamoter. Quand le marxiste se fait critique littéraire, l’injonction à l’art officiel réaliste n’est jamais loin… Mais le parangon de cette sorte de scission schizophrénique serait un philosophe : « Le conflit entre la vie quotidienne telle qu’elle est — telle qu’elle a été faite par la bourgeoisie — et la vie que réclame, exige, appelle de toutes ses forces l’être humain actuel, ce conflit a déchiré Soren Kierkegaard. »
Et puisque « le petit bourgeois ou le bourgeois, comme tels, s’interdisent l’accès à l’humain », seul « le prolétaire, en tant que prolétaire, peut devenir un homme nouveau ». Nous y voilà : c’est qu’il faut encore subir matériellement l’aliénation, dans sa chair pour ainsi dire, et non pas seulement cérébralement, pour prétendre s’en délivrer (ou du moins, c’est ce qu’on en déduit, parce que la transition n’est pas très claire : au fond, on ne voit pas bien ce qui sauverait le prolétaire, si ce n’est bien sûr la possibilité qu’il aurait d’accéder à une conscience de classe, une transcendance donc, quand pour le bourgeois, emmuré derrière sa conscience privée, irrémédiablement individualiste, nul salut ne serait plus possible, quoi qu’il en ait du haut de toute son érudition critique, et ici l’on ne peut s’empêcher de penser, pour dresser un parallèle avec l’actualité, à tous ces petits bourgeois qui font mine d’aduler le candidat Philippe Poutou, donnant en l’occurrence raison, dans tout leur ridicule, à Lefebvre). C’est toujours pareil avec les marxistes, incorrigibles : implacablement lucides quant aux fausses idées que les hommes se font à propos d’eux-mêmes, ils ne peuvent s’empêcher de croire une rédemption possible, entre les mains d’un peuple élu, et tombent à leur tour dans le rêve idéaliste qu’entretient leur sotériologie particulière : sous la croûte de l’homme aliéné percera l’homme nouveau, et à l’horizon, la révolution — tout un fatras mystique qui semble aujourd’hui terriblement daté. Si les hommes se font des idées fausses, c’est qu’il doit bien y en avoir quelque part une de vraie, d’idée, pensent-ils, et de préférence la leur ; mais s’il n’y avait nulle aliénation à guérir, et sous l’apparence, rien à gratter ? Sous la croûte, rien que du pus ? Quelques soixante-quinze ans plus tard après la première parution du livre, force est de constater que l’homme nouveau est encore resté dans les cartons… (Lefebvre objecterait sans doute qu’il nous a manqué pour cela un « parti politique s’efforçant de guider et d’entraîner les masses humaines » afin de réaliser « la transformation du monde » tendant vers « un nouveau type humain », brrr, ça fait un peu froid dans le dos.)
S’il me fallait ne retenir du livre qu’une phrase, ce serait ce principe à la fois tout simple, élémentaire même et, sur le papier, imparable : « La critique de la vie consiste alors dans l’étude de la marge qui sépare ce que les hommes sont de ce qu’ils croient être, ce qu’ils vivent de ce qu’ils pensent ». Mais est-ce encore seulement possible, d’être intégralement intègre, quand les vices du capital se sont insinués dans tous les interstices de la vie ? J’étais au ski au moment où je lus cette phrase, c’est sans doute pour cela qu’elle m’a particulièrement frappé, car elle me prenait comme en flagrant délit. C’est que, quand je vois la montagne défigurée, toute couturée de prothèses métalliques (qui, sur ce fond blanc, ont quelque chose de l’appareil dentaire), arrosée de neige artificielle pour le bon plaisir de la bourgeoisie (petite comme grande), je sais l’aberration et l’obscénité d’une forme indéniablement nuisible de loisir (défrichement des glaciers, ponction d’eau dans les lacs de montagne, ruée automobile vers les stations etc.). Et pourtant… Je n’y vais désormais que très occasionnellement, quand la possibilité se présente (j’ai skié trois jours cet hiver, et la fois d’avant, il y a deux ans, j’avais skié deux jours, après une interruption de trois ans), justement parce que c’est un luxe, disons que ce sera ma circonstance atténuante, mais quand j’y suis, dévalant seul, sans temps mort, depuis les sommets, libre enfin pour quelques heures (aussi illusoire cette liberté fût-elle, car la sensation, elle, ne l’est pas), comment bouder mon plaisir ? Alors, avec mauvaise foi, cédant au coupable élitisme, je me donne bonne conscience : le problème ce n’est pas moi, c’est les autres, c’est la masse. Pourquoi moi, qui skie depuis plus de trente ans, devrais-je y renoncer ? Ne sont-ce pas tous ces skieurs du dimanche, ces touristes en patinettes, ces dangers publics en chasse-neige qui devraient se désister, pour laisser la place aux skieurs aguerris ? Qui n’a jamais été formé au judo, par exemple, envahit-il les tatamis ?
D’accord, mettons, mais… S’il n’y avait pas la masse, sans doute n’y aurait-il pas non plus les télésièges… Et alors, voudrais-je vraiment remonter chaque piste à pied ?

Last modified: 7 mars 2024