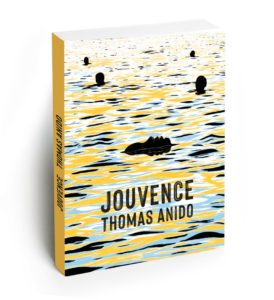Ça commence par des embouteillages. À moins qu’on ait eu la prévoyance et le privilège de tirer au sort un ticket de train, tous liquidés dès trente minutes après leur mise en vente, si bien qu’on a dû se résigner à la bagnole, qui nous épargnait au moins, s’il faut absolument voir le verre à moitié plein, le transfert à pied, entre escales, d’un barda d’enfer, ballotés d’abord par les reflux imprévisibles de la gare, anxieusement tendus ensuite vers le repérage des places, dans le wagon qui d’entrée sature, jonché d’équipements massifs : les énormes valises pleines à craquer de masques, casques, gants, pulls et bonnets, et même les skis et les chaussures pour les plus acharnés ; autant dire des grandes lattes et des enclumes qu’on ne sait par où agripper pour les soulever. On mesure déjà le niveau de fétichisme du skieur propriétaire, non pas de son chalet cossu au pied des pistes, mais, à défaut, de cet attirail si malcommode à transporter qu’il trimballe comme sur le Calvaire d’un bout à l’autre de la France, et avec le sourire encore (au moins Jésus n’avait-il pas, en sus de la croix, à se traîner une de ces horribles paires de groles !).
En voiture, folie d’un autre genre — partir tous en même temps, dans la même direction — qui dans notre monde est chose quotidienne et banale, allant de soi — tant notre forme de vie, dont toutes les artères petit à petit se bouchent, est panurgisme, quoiqu’elle prétende le contraire — mais qui pourrait être tenue dans un autre pour une déviance passible de camisole. Ainsi voguons-nous d’un bouchon à l’autre, comme on en connaît rarement puisqu’on peut encore en tout autre occasion se donner les moyens d’esquiver les heures de pointe, sauf pour les vacances au ski où tout conspire — périodicité des locations et des cours de l’ESF oblige — à vous emboîter du samedi au suivant (route comprise, ce qui ampute déjà votre séjour d’un bon quartier). D’abord on s’impatiente, puis se résigne vite à l’impuissance, à parcourir sept cents kilomètres à cinquante de moyenne. On relativise : après tout, comparé à la marche, bagages au dos, c’est déjà supersonique. Les stations-service sont pleines comme des stades, il y a des mouvements de foule, les machines à café crachent de l’eau tiède et les toilettes dégorgent leur trop plein. On serre les dents, et se console un peu vite à l’idée qu’au bout du tunnel, ce sera la délivrance — c’est pécher par excès d’optimisme. En réalité, une foule d’autres formalités assommantes, pour ne pas dire des épreuves, devront être accomplies dans l’angoisse, le coup de chaud et la sueur — entrée dans le logement, récupération des forfaits, location et rapatriement des skis (et chaussures et bâtons), tour de force d’autant plus périlleux que nous échoit aussi le matériel des enfants —, d’autres files d’attente font encore obstacle aux pistes. Chez Ski Set, en guise d’essayage, on vous fait monter sur une petite plateforme électronique, comme un pèse-personne, sauf qu’elle n’est pas destinée à vous peser mais à mesurer vos pieds, de sorte qu’on vous attribue ensuite votre paire sans qu’il soit nécessaire de l’enfiler, le verdict de la machine étant supposé plus fiable que le vôtre, capable qu’elle est de scanner les moindres anfractuosités de votre voûte plantaire pour en déduire le modèle idoine. « Eh oui — commente pour nous l’employé fier de son nouvel outil, son petit bijou — imaginez-vous que le samedi, on doit sortir six-cents skis, alors ça aide ! » Ainsi le cheptel passe-t-il à la pesée — pour un peu on lui tatouerait la fesse — avant que sa marmaille ne soit acheminée vers les pouponnières de l’École du Ski Français. Ultime supplice en effet, puisqu’avant que ne soit dûment actée la prise en charge, le moniteur ayant enfin comptabilisé chacune des têtes casquées, à jamais anonymes et méconnaissables, venant sous sa garde, on tremble pour la chair de sa chair lâchée dans la cohue, redoutant à chaque seconde que le processus ne déraille et n’aboutisse, suivant un improbable écheveau de causes et d’effets imaginaires que seule sécrète la profuse paranoïa du parent, à la perte pure et simple de l’enfant. Ce dernier cap franchi, nous y sommes enfin, sur les pistes ; faut-il que la caste soit docile, mûrement domestiquée, pour endurer sans broncher, gardant toujours l’esprit civil, une telle cascade de corvées !
Nous le savons pourtant, ce monde est condamné, comme en témoigne, face à l’ubac enneigé, l’adret déjà rendu aux herbes folles. Nul besoin d’ailleurs de porter le regard si loin, vers le versant opposé, car c’est aussi de l’herbe que foulent nos pieds dès qu’ils franchissent d’un pas la frontière aval du domaine skiable, ainsi nettement délimité, au bas duquel d’ailleurs, s’il reste de la neige, celle-ci se fait soupe en fin de journée, rafistolée chaque nuit à coups de canons d’artifice. Certes elle prendra du temps, l’agonie des neiges, qui sait quand on en verra la fin, dans combien de générations, mais elle progresse aussi à vue d’œil et les amateurs ne s’y trompent pas, qui guettent avec anxiété les bulletins météo : le jour n’est pas si loin où les sports d’hiver tels qu’on les a connus n’existeront plus. Qu’est devenue la nappe épaisse immaculée d’antan, qu’on étrennait au matin après la tempête, cette poudre divine, mer étale de cristaux irisés, sur quoi l’on flottait et dans quoi l’on se coulait d’un seul et même mouvement ? D’ici là, c’est la ruée toujours plus haut : n’entends-je pas ce type, dans les télécabines, dire à son voisin qu’il a vu des vidéos prises à La Plagne, une des stations les plus élevées de nos Alpes, avec des queues monstre aux télésièges ? Mais ne cédé-je pas alors à la nostalgie factice du « mieux avant », n’était-ce pas déjà la même foule il y a quinze ans ? Mon oreille s’est tendue, et pour cause, La Plagne, non loin du Val Cenis où je me trouve alors (non loin du moins à vol d’oiseau), ce fut longtemps mon fief, j’y ai skié pendant bien vingt ans grâce à l’appartement familial, vendu depuis, mais les queues monstre dont je me souviens, c’était avant la rénovation complète du parc de remontées mécaniques, multipliant alors leur débit par cinq ou par dix (jusqu’à 4800 personnes par heure, fut-il alors inscrit sur les panneaux de certains télésièges dernier cri, soit la population totale d’un gros bourg !), avec en prime la création d’une liaison titanesque enjambant la vallée jusqu’aux Arcs ; et voilà donc que ça sature à nouveau à ce qu’on dit, malgré même la flambée consécutive du prix des forfaits — folie des grandeurs, encore et toujours, exponentialité sans frein de la course aux rendements, précipitation aveugle de la catastrophe, et de ses masses accourues en rangs serrés.
Loisir de bourgeois, dit-on, et c’est vrai, qui balafre la montagne, la presse comme un citron, tire au forceps les dernières gouttes d’un jus amer, dans l’insolent déni de l’effondrement en marche. Oui certes, mais voilà : s’il requiert une aberrante infrastructure, s’il coûte effroyablement cher toutes prestations mises bout à bout, en bon agent rationnel je calcule aussi que, si je devais sacrifier mon bon plaisir, le gain infinitésimal, nul même, ainsi engendré en faveur de l’intérêt général serait incommensurable à l’étendue de la perte que cela représenterait pour moi : rarement en effet je me sens aussi bien qu’à skis. Tout le monde ne mène pas la vie aventureuse qui lui permet de partir en week-end à l’ascension pédestre des sommets, avec sous les skis des peaux de chamois, pour, une fois parvenu là-haut, dévaler les pentes vierges, bardé de sponsors et filmé par des drones. Alors d’ici la fin de la neige, la Terre peut bien brûler.

Last modified: 14 novembre 2024