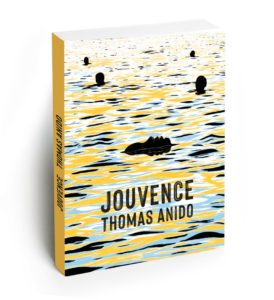Dans son impressionnant Christophe Colomb Héraut de l’apocalypse, Denis Crouzet tente, mais en historien rigoureux, de nous faire appréhender la découverte de l’Amérique depuis la perspective intime de l’Amiral de la Mer Océane, qui n’était selon lui ni un pionnier héroïque, ni un Hitler en herbe, ni un opportuniste mythomane, ni quelque homme théorique opérant une jonction imaginaire entre Anciens et Modernes, mais un illuminé de Dieu, accomplisseur messianique des prophéties d’Isaïe, se croyant vecteur malgré lui de la parole divine, l’élu devant conduire l’humanité entière à son salut, c’est-à-dire à la fois le ralliement des Indes, la conversion des Gentils, la reconquête de Jérusalem (ainsi que tout l’or nécessaire au financement d’une telle croisade), la fin (et donc le début) des Temps depuis le jardin d’Eden, soit le fourre-tout idiosyncratique d’un mystique autodidacte, interprétant toutes les vicissitudes de sa mission comme autant de signes à même de renforcer sa détermination, aussi contradictoires ou terribles fussent-ils (ainsi l’homme s’accommode-t-il, via les contorsions et clivages de sa voix intérieure, de ses erreurs et de ses échecs), ajustant sans cesse à leur aune le discours de ses relations de voyage. Nous sommes renvoyés à ces temps inconcevables pour nous où la géographie, lacunaire, était encore labile, où l’existence d’îles fantômes surgies d’anciennes rumeurs était attestée par les atlas et les portulans (Île de Saint-Brendan), où des cités mythiques, couvertes d’or, qu’habitaient cyclopes et hommes cynocéphales, somnolaient encore dans les ténèbres dans l’attente de l’Évangile.
Transe heuristique
Et Colomb de négocier sans cesse avec lui-même au gré des circonstances une cartographie mobile : le Çypango mentionné dans Le livre des merveilles de Marco Polo, autrement dit le Japon, c’est d’abord San Salvador où les caravelles accostent en premier lieu, et puis non, finalement c’est Juana (Cuba), à moins que Juana ne soit déjà la terre ferme comme il en décidera ensuite, ce fameux Cathay du grand Khan (l’empire sino-mongol aussi révélé dans le livre du précurseur vénitien) qui lui ouvrira la route de la Chersonèse d’or de Ptolémée, et dès lors il confond plutôt Çypango avec Hispaniola (Haïti / Saint Domingue) plus à l’est, à en croire les indiens eux-mêmes puisque, prodigieuse coïncidence d’une homophonie certes approximative (au sujet de laquelle l’a raillé plus tard Adam Smith, dans La richesse des nations), ceux-ci mentionnent justement une région intérieure qui s’appelle Cibao et recèlerait de grandes quantités d’or : une preuve de plus dans le système sémiotique halluciné de l’Amiral qui baptise, comme s’ils venaient d’émerger de la création, l’un après l’autre tous les sites par lui foulés et reconnus, pour en faire la propriété des Rois Catholiques. De tout bois il fait un feu biblique ; noms de saints et noms mariaux, noms d’animaux inspirés de reliefs zoomorphes, en écho aux éléphants et tortues du Livre des merveilles, noms fleurant l’apocalypse : ainsi du Cap Alpha et Omega à l’extrême pointe est de Juana, pendant occidental du finistérien Cap Saint-Vincent au Portugal.
Comment les sables stériles de Mars, que nous font miroiter de vagues clichés intermittemment transmis par les robots tout terrain dépêchés sur place, pourraient-ils bien ressusciter une telle transe heuristique ? Rendons-nous à l’évidence : nous n’avons plus rien à découvrir (allez, nous accoucherons bien encore d’algorithmes-à-tout-faire, nous enverrons bien nos fusées toujours un peu plus loin, et nous prolongerons bien notre espérance de vie de quelques mois… et encore !). Vu les dégâts collatéraux qu’occasionnent à chaque fois nos découvertes, ce n’est d’ailleurs peut-être pas plus mal que tout l’univers ait déjà été gagné à la transparence…Tout ce qui nous reste à jouer, c’est l’accroissement du loisir et du confort, et accessoirement, une fois seulement qu’on a bien joui et mangé à sa faim, le secours ostentatoire porté à la misère, bien sûr !
« Qu’on rende gloire au Seigneur, et qu’on publie ses louanges dans les îles. Le Seigneur s’avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il poussera des cris et des hurlements comme un héros contre ses ennemis. Pendant longtemps je me suis tu, j’ai gardé le silence, je me suis contenu : comme une femme en couches je gémirai, je soupirerai et m’essoufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et j’en dessécherai toute la verdure ; je tarirai les eaux et les changerai en îles, et je mettrai les étangs à sec. »
Extrait du chapitre 42 du livre d’Isaïe, dans la traduction qu’en donne Denis Crouzet
Du paradis à l’enfer
Le premier voyage, le Gran viaje, c’est le premier regard qui glisse, sans rien pouvoir saisir, sur la surface inouïe de l’exotique, l’émerveillement sans recul qui s’imprime hyperbolique sur la rétine vierge encore de tant d’inconnu, devant le spectacle enchanté de cette flore exubérante, de ces animaux fabuleux, de ces bons sauvages adamiques, nus et candides comme des enfants : le prophète du salut n’en attendait pas tant — naïveté coupable du premier élan — pour conclure au paradis sur Terre. À propos de cette extase inaugurale, que Colomb semble-t-il surjoue sans cesse, d’île en île, dans son diario, et qu’il tentera encore de réactiver ponctuellement lors des voyages suivants, après même l’enclenchement inéluctable de la catastrophe, Denis Crouzet cite le rêve de Nerval dans Aurélia : « une clarté blanchâtre s’infiltrait peu à peu dans ces conduits, et je vis enfin s’élargir, ainsi qu’une vaste coupole, un horizon nouveau où se traçaient des îles entourées de flots lumineux. » (On pense aussi à la seule séquence réussie du 1492 de Ridley Scott, sur la musique de Vangelis, kitsch peut-être mais idoine, quand la brume se dissipe pour laisser apparaître enfin la terre promise, la profusion des frondaisons qui se dévoilent pour emplir le cadre, délivrant Colomb in extremis de la menace d’une mutinerie — film par ailleurs qui tombe dans tous les travers hollywoodiens possibles, faisant de l’Amiral, à rebours de toute historiographie sérieuse, l’incarnation de la raison progressiste contre l’obscurantisme de l’Espagne de l’Inquisition, dont il était en fait sans doute la figure de proue ; Depardieu jouant le héros impétueux, actif et volontaire à la Jules Verne, entraîné contre son gré par les méchants, indigènes ou espagnols, dans la spirale de la violence.)
Le deuxième voyage, quand à son arrivée à Hispaniola Colomb retrouve tous morts les trente-neuf hommes qu’il avait laissés sur place le temps d’aller annoncer la bonne nouvelle en Espagne et de revenir en force (dix-sept caravelles !), c’est la première déconvenue d’une longue série, et il y voit l’épreuve à laquelle Dieu le soumet, il voit aussi se profiler Satan derrière le péché dont il découvre les indiens non exempts, ce qui justifiera de déchaîner contre eux la violence, de les rançonner, les esclavagiser, les mutiler et les tuer sans compter, son Dieu d’amour se muant de bon droit en Dieu de terreur à la moindre résistance, car rien ne doit faire obstacle à l’avènement du millénarisme, ni à sa quête éperdue d’un or introuvable, si ce n’est en quantités dérisoires ; n’était-ce pourtant pas tout simplement cette désillusion prévisible qui suit toujours de très près l’idylle chimérique ? Or, fallait-il qu’il soit aveuglé de se croire bras de la Providence pour ne pas voir que ce qui avait changé le paradis en enfer, entre le premier et le deuxième voyage, ce n’étaient pas les Indiens, mais les Espagnols, croupissant maladifs sous des tropiques dont le climat s’était finalement révélé hostile, usurpant voracement les femmes, les richesses et les terres des autochtones. Le paradis existait bien : il ne tenait qu’à leur absence, ainsi donc qu’à l’absence de leur Dieu.
« Par Dieguito, le seul qui me restait, j’appris que ces hommes n’avaient pour nous ni amour, ni admiration ; ils nous tenaient pour perfides, violents et cruels, ils trouvaient que nous étions sales et que nous sentions mauvais, ils étaient surpris de voir que nous ne nous baignions jamais, eux qui, plusieurs fois par jour, rafraîchissaient leur corps dans les rivières et les cascades de leur pays. »
Alejo Carpentier, La harpe et l’ombre (traduction René L.-F. Durand)
En irait-il de même du capitalisme qui, pour avoir tout découvert puis infiltré, aurait tout sali ?
Post-scriptum :
Dans son curieux, bien documenté et très inégal roman La harpe et l’ombre, convoquant entre autres les figures du pape Pie IX, de Bartolomé de Las Casas, de Léon Bloy, de Victor Hugo et de Jules Verne, Alejo Carpentier choisit de dépeindre un Colomb trop humain, c’est-à-dire qu’il opte, parmi toutes les extrapolations possibles du personnage, pour celle de l’ambitieux sans scrupules et prêt aux plus roués des stratagèmes pour auréoler son propre nom d’une gloire éternelle (en passant, et pourquoi pas, Carpentier en fait aussi l’amant d’Isabelle la Catholique) : si c’est une manière, peut-être salutaire, de faire tomber le héros de son piédestal, cela revient aussi à occulter son fanatisme messianique, affaiblissant ainsi la dimension tragique de son rôle dans l’Histoire.
« S’il y avait donc à désigner un vrai coupable se cachant dans l’ombre du Découvreur criminel, Christophe Colomb, ce serait le pouvoir de séduction, cycliquement réactivé, d’un imaginaire eschatologique se parant certes d’oripeaux contingents mais toujours assurant que la violence est seule conditionnelle de l’avenir d’une humanité devant aller nécessairement vers une fin utopique de l’histoire, vers un meilleur des mondes, meilleur parce qu’il aurait éradiqué une partie de ses vivants. »
Denis Crouzet, Christophe Colomb Héraut de l’apocalypse (éditions PUF, collection Quadrige)

Last modified: 11 novembre 2024