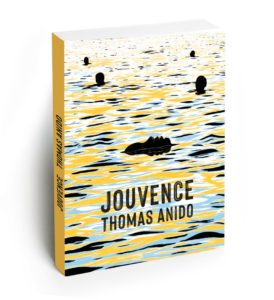Lire l’épisode précédent : où un semblant de problématique est posé.
Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, du fait des grands voyages de ma jeunesse en Amérique du Sud, ainsi que des fortes sensations et des liens affectifs qu’avait occasionnés chez moi, à l’âge où l’on peut être à la fois malléable comme la pâte et aussi enragé qu’un sans-culotte, l’immersion complète dans un contexte socio-culturel exotique, à savoir celui des hauts plateaux andins, le mandat tragiquement abrégé de Salvador Allende a persisté dans mon imaginaire personnel comme mythe d’une utopie socialiste qui, si elle n’avait été réprimée par les forces obscures du Kapital, aurait enfin actualisé avec succès le rêve d’une révolution démocratique (bien sûr, on me dira, et sans doute avec raison, que c’est un penchant banal : le Chili d’Allende, c’est, un peu comme l’épopée de Che Guevara, le bréviaire du gauchiste vingtenaire — la dérive sanguinaire en moins… mais j’avais au moins pour moi de m’être attaché sur place, soit en meilleure connaissance de cause, à cette tradition mémorielle).
Et puis je suis tombé dernièrement, un peu par hasard, sur une « publication scientifique » du Journal of Development Economics datant de 1990, intitulée Macroeconomic populism, procédant en une trentaine de pages à une analyse comparée des effets de deux stratégies économiques dites populistes : celle menée par l’Unitad Popular au Chili sous la présidence d’Allende (1970-1973), et celle menée au Pérou par Alan Garcia à la fin des années 1980. Je ne sais rien des auteurs, Rudiger Dornbusch et Sebastian Edwards, mais en bons économistes américains, je suppose qu’ils étaient de droite, sans doute très libéraux — pire même : néolibéraux, vade retro ! — et biberonnés à l’école de Chicago ; néanmoins, leur travail se voulait froidement impartial quant aux motivations proprement politiques à l’origine des programmes économiques mis en œuvre, aspect d’ailleurs qu’ils excluaient explicitement du périmètre de leur étude, tout en ayant l’honnêteté d’admettre qu’il avait sans doute eu sa part d’impact sur l’issue historique, et malheureuse, des deux expériences analysées, selon une approche pragmatique typiquement nord-américaine qui transparaît dans une sorte de disclaimer concluant leur introduction :
« Before embarking on the case studies we emphasize that we do not cover the political issues which surely are equally if not more important in the historical developments in the two countries. We omit politics not because we think they are irrelevant, but because we want to highlight to the clearest extent possible the economic developments. The view we present is therefore possibly biased because it omits the political motivation, on occasions, for economic motives. »
Et ce qui m’a frappé en lisant l’étude, du moins pour ce que j’en ai compris puisque ses développements les plus techniques outrepassent mes compétences en la matière, c’est justement de constater, une fois mis de côté les louables idéaux d’égalité et de justice qui ont indubitablement présidé au formidable élan populaire débouchant sur l’élection d’Allende (à une très courte majorité relative), avec son cortège mémorable de poètes (Pablo Neruda, Nicanor Parra) et de musiciens folkloristes (Victor Jara, Inti-Illimani, Quilapayún) exaltant l’âme du peuple indien opprimé (rappelons néanmoins que le pays était alors gouverné par un parti démocrate-chrétien, porteur de réformes keynésiennes déjà impuissantes à enrayer la stagnation), que la stratégie économique de l’Unitad Popular avait conduit le pays à rien de moins qu’une catastrophe sociale.
Lire la suite : où l’on confesse un conflit de loyauté

Last modified: 13 mai 2025