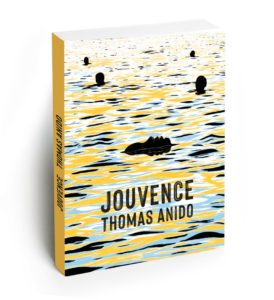Lire l’épisode précédent : où l’on passe du coq à l’âne
Dans l’un de ses posts quotidiens — et ce sera là mon dernier exemple puisé chez ces écrivains du web, exemple qui, par rapport aux deux précédents, relatifs à des prises de position circonstanciées (souvenons-nous : sur la journée de travail de trois heures puis sur la retraite par capitalisation), m’offre une montée en généralité tombant à pic pour illustrer mon propos — l’un des plus éminents d’entre eux, si l’on me demande mon avis, et d’habitude plutôt enclin à récuser le gauchisme pavlovien de ses confrères, associe le fait d’être « de droite » (sont-ce des guillemets de nuance qu’il utilise, ou plutôt une pince pour se boucher le nez ?) avec l’absence, pêle-mêle, de goût, de raffinement, de sens esthétique, une absence béante même, c’est vous dire la barbarie de cette engeance, ce qui lui permet d’en déduire, et voilà qui donnera plus d’eau encore à mon moulin, que ceux des progressistes qui réclament qu’on réforme d’autorité la langue pour la rendre plus simple et partant plus accessible — donc plus laide — sont en fait objectivement de droite.
Au passage, je peux me tromper mais, si on lui demandait, à propos des conservateurs qui s’opposent justement à ces partisans de l’appauvrissement par décret du langage, si cela en fait du coup des gauchistes à l’insu de leur plein gré, je crois bien qu’il répondrait quand même par la négative, puisqu’au fond, ce qu’on peut lire en filigrane, et désolé si je ne rends pas pleinement justice aux subtilités de son argument, c’est : la droite égale le méchant capitalisme aka le culte du fric aka le mal — la revendication d’une simplification de la langue s’y apparentant indirectement par l’utilitarisme obtus dont elle témoigne — et la gauche égale… égale quoi d’ailleurs ? Difficile à dire tant elle semble chez lui se définir en négatif par rapport à la droite, mais risquons-nous y donc : la gauche égale tout ce qui n’est pas le culte du fric et ses funestes conséquences tous azimuts, soit la gauche = le bien, le vrai le juste et le beau, par la grâce commode d’une pétition de principe. Au fond la gauche serait une sorte d’essence immuable, portant le monopole du bon goût, de la bienfaisance et de la charité, affranchie à jamais des rapports de force idéologiques en jeu hic et nunc (en quoi somme toute, un tel discours, quelque apparence de sophistication littéraire qu’il se donne, ne dit pas autre chose que n’importe quelle vieille baderne du PS qui, outrée de ne plus reconnaître en LFI sa bonne vieille gauche soc-dém’, répète à qui veut l’entendre que « c’est pas ça, la vraie gauche ! »). C’est faire trop bon marché des clivages complexes, et mouvants, entre dextre et sénestre, que de les réduire à la seule dimension d’une alternative puérile entre méchant capitalisme et gentil communisme (ainsi appelle-t-il de ses vœux, sans trop se mouiller, un « communisme élitaire », quoi qu’un tel oxymore puisse bien vouloir dire : ça sonne un peu comme l’aristocratie nietzschéenne des esprits forts, mais en plus inclusif), comme si le communisme, si irrévocablement disqualifié par l’histoire, pouvait encore prétendre au statut d’option crédible ; comme si l’économie de marché, malgré toutes les tares congénitales, dégâts collatéraux et effets indésirables dont je ne la dédouane pas, ne faisait pas l’objet d’un consensus tacite.
Par parenthèse, si je devais absolument me prononcer sur la question du capitalisme, je partirais peut-être de la critique que Bouveresse en prête à Musil (je ne retrouve hélas pas la source exacte de la citation, il faudra me croire sur parole) :
« Il dit que le capitalisme est le système le plus rationnel, le plus efficace, le plus flexible et le plus productif d’exploitation et d’organisation de l’égoïsme humain. C’est ce qu’il appelle la « spéculation à la baisse » : la spéculation sur ce qu’il y a de plus inférieur en l’homme et, par conséquent, aussi de plus sûr. Il n’y a jusqu’à présent que ce système qui ait réussi à produire entre les hommes un mode de coexistence à peu près supportable, mais à un prix extrêmement fort. Le capitalisme, dit Musil, engendre le progrès, mais il ne peut engendrer aucun ordre, et surtout pas un ordre humain. »
Tout dépend alors de ce qu’on entend par ordre, et s’il s’agit, tel que je le comprends, d’un cadre transcendant qui subordonne la licence accordée à la partie — l’individu — à l’harmonie du tout — la société —, l’idée semble trahir comme une nostalgie chimérique des systèmes holistes dont nous sommes de longue date sortis. Car : comment les sociétés individualistes pourraient-elles rétablir un tel ordre, si ce n’est par la coercition ? (Au passage, ce n’est pas le moindre des paradoxes que des écrivains, soit par définition des individualistes forcenés, fantasment un âge d’or au sein duquel le Moi se dissolvait dans le Tout) C’est que, si l’on suit l’anthropologue Louis Dumont, les temps où l’ordre primait l’autonomie individuelle, que celui-là soit d’inspiration naturelle, sacrée ou traditionnelle, sont derrière nous — en Occident du moins ; ce dont je crois pouvoir déduire que, hors la religion, la tribu ou la hiérarchie des castes qui maintiennent de-ci de-là leur emprise, il n’y a guère plus que la dictature — le parti ! — qui puisse le restaurer. Suivant cette perspective, le libéralisme économique ne consisterait pas tant à capitaliser cyniquement sur l’égoïsme humain qu’à abroger radicalement l’autorité planificatrice que requiert l’instauration de tout ordre humain compris comme « plan unique », pour parler comme Friedrich Hayek dans la Route de la servitude : qui peut encore croire pouvoir ériger « le code éthique complet où toutes les valeurs humaines sont mises à leur place légitime », quel esprit central, fût-il collectif, peut prétendre embrasser « l’infinie variété des besoins divers d’individus divers qui se disputent les ressources disponibles et attachent une importance déterminée à chacune d’entre elles » ? Pour qu’une autre sorte d’ordre émerge, spontanée celle-là et non pas à la main d’un haut clergé, autant s’en remettre alors à des forces impersonnelles — appelez ça libre concurrence si vous voulez, ou main invisible du marché, ou catallaxie, ou encore : le processus qui génère, à partir de nos myriades d’actions intentionnelles, une distribution de la richesse, du pouvoir et de la responsabilité qui ne résulte de l’intention de personne (c’est moi qui traduis ici la caractérisation qu’en donne Roger Scruton) — susceptibles d’arbitrer la fluctuation des positions de la multitude d’acteurs évoluant sur l’échiquier, et de reconduire dans la sphère anthropique le mariage du hasard et de la nécessité qui régit le mécanisme aveugle de la sélection naturelle. Nul darwinisme social ici, ni panglossisme : il ne s’agit ni de s’en remettre à la loi du plus fort, ni de croire que grâce aux seules forces impersonnelles du marché, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Convenons avec Bouveresse / Musil, et contre les libéraux pur jus, que le marché est loin de répondre à soi seul aux problèmes de coordination sociale auxquels sont confrontées les sociétés individualistes, ne serait-ce que parce que, livré à lui-même, il assèche la riche panoplie des fins humaines en la restreignant à l’enrichissement personnel dont découlent naturellement la désagrégation des solidarités, le saccage du monde et la vacuité consumériste. Ainsi faudrait-il plutôt le concevoir, à l’instar de Roger Scruton dans son article sur le rapport de Hayek au conservatisme, comme un cadre contractuel auquel donnent son expression tout en contrebalançant ses effets nocifs d’autres sources d’ordre spontané, lentement décantées par l’histoire, comme les traditions morales, légales et culturelles, ou plus généralement, les formes de vie locales. Mais plutôt que d’entériner la prévalence de ces dernières, pour les traduire comme fait accompli dans la loi et les institutions, voici que notre état contemporain se pique de social engineering, prétendant façonner à sa guise et jusque dans leurs moindres détails l’opinion et le comportement du citoyen, contre le gré de ce dernier s’il le faut, sous couvert de progressisme et d’égalitarisme, et déployant à cet effet tout un arsenal d’emprise idéologique : radiotélévision publique, médias associations et artistes subventionnés, fonctionnaires surnuméraires et toute la foule des débiteurs de l’état vivant à ses crochets. Ainsi les velléités de réforme du langage par décret dont je parlais plus haut relèvent-elles moins du méchant capitalisme que de l’extension à tous les domaines de l’existence de l’ingérence dirigiste d’État…
Fermons la parenthèse en en revenant à la littérature, non pas celle des têtes de gondole mais la vraie : est-on vraiment bien sûr qu’elle ne respirerait pas un peu mieux (oh, ne serait-ce qu’un tout petit peu !) au sein d’une économie plus libérale, si, pêle-mêle : on démantelait les monopoles de fait qui, via des groupes tentaculaires, verrouillent le secteur à double tour ; on mettait fin au népotisme et à l’entre-soi qui règnent dans le lupanar consanguin des prix littéraires ; le coût du travail n’était pas prohibitif pour les éditeurs de niche ; les subventions aux libraires étaient conditionnées par la prise de risque éditoriale, afin que leurs étals ressemblent un peu moins à ceux de la Fnac ; les distributeurs n’ostracisaient pas les petits catalogues ; les chaînes publiques ne se contentaient pas de servir au public la même soupe que leurs homologues privés etc.
« Dans nos prédilections et nos intérêts nous sommes tous en quelque manière des spécialistes. Et nous pensons tous que notre échelle personnelle de valeurs n’est pas simplement personnelle, mais que dans une libre discussion entre gens raisonnables nous arriverions à faire reconnaître la justesse de nos propres vues. L’amateur de paysages champêtres qui veut avant tout préserver leur apparence et effacer les insultes faites à leur beauté par l’industrie, tout autant que l’hygiéniste enthousiaste qui veut démolir les chaumières pittoresques et insalubres, ou l’automobiliste qui veut voir partout de bonnes routes bien droites, le fanatique du rendement qui désire le maximum de spécialisation et de mécanisation, et l’idéaliste qui, au nom des droits de la personne humaine, veut conserver le plus possible d’artisans indépendants, tous savent que leur but ne peut être totalement atteint que par le planisme, et c’est pourquoi ils veulent le planisme. »
Friedrich Hayek, La route de la servitude, traduction Georges Blumberg
À suivre…
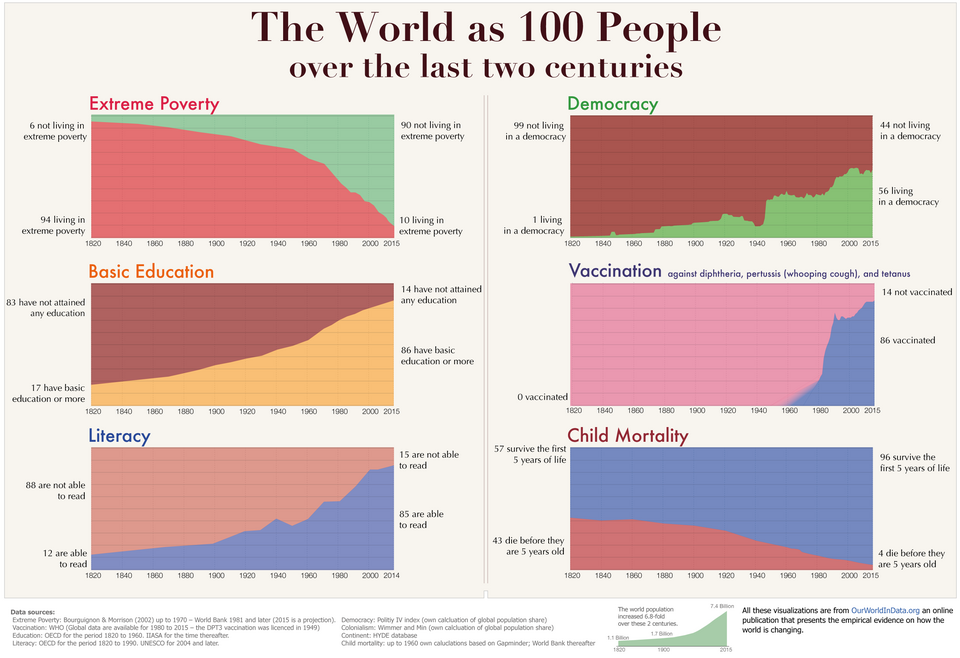
Last modified: 19 septembre 2025