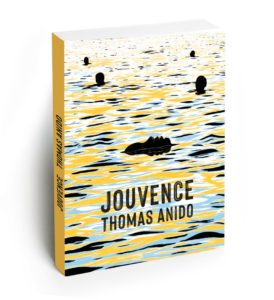À propos du Sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz, traduction de Thérèse Douchy, Allan Kosko, Georges Sidre et Suzanne Arlet, dans la collection L’imaginaire de Gallimard
Difficile de résumer d’un mot le style de ces nouvelles de Bruno Schulz réunies sous le titre de la plus kafkaïenne d’entre elles, qui fait aussi penser au troublant roman du méconnu Hermann Kasack, La ville au-delà du fleuve, tant porteur de promesses d’ailleurs, celui-là, que sa fin laisse un peu le lecteur (en tout cas moi) sur sa faim, justement— à cause même peut-être de son twist, efficace mais banalisé depuis par Hollywood, presque convenu aux yeux des post-modernes épuisés que nous sommes (tel personnage qu’on croyait vivant (bien que très bizarrement vivant) depuis le début s’avère en fait mort, hantant une sorte de réalité parallèle).
Étonnant d’ailleurs à quel point le principe de la nouvelle de Schulz en question, Le sanatorium au croque-mort, et celui du roman de Kasack sont proches, ce narrateur débarquant en train dans une ville inconnue pour y retrouver son père exilé-mort, sauf que, premièrement, le roman de Kasack, étant un roman, bien plus étoffé donc en péripéties, nous représente un système assez complet (par système complet, entendons un monde possible dont suffisamment de facettes et de règles nous sont explicitées pour qu’on ait le sentiment d’en saisir une vision d’ensemble — un des parangons du genre pouvant par exemple être cherché du côté des Jardins statuaires, de Jacques Abeille), et que, deuxièmement, Schulz ne nous laisse pas croire longtemps que son père est vivant, ni ne nous dit qu’il est complètement mort, il ne joue pas sur ce retournement-là, ou du moins de façon moins tranchée, « la mort qui a atteint votre père là-bas n’est pas arrivée ici », explique au narrateur le docteur Gotard, l’une des figures ectoplasmiques de ce purgatoire où l’on a retardé le temps « d’un certain intervalle de durée qu’il est impossible de déterminer », avec pour conséquence, ou corollaire, comme s’en rendra compte plus tard le narrateur, qu’à « chaque endroit et à chaque moment on est toujours prêt à s’accorder un petit somme, la tête appuyée sur la table au restaurant, ou en fiacre, ou même debout, dans le vestibule d’une maison quelconque où l’on est entré un moment pour céder à un irrépressible besoin de sommeil » avant de reprendre au réveil, comme si de rien n’était, « la conversation interrompue », de poursuivre « notre route pénible », de continuer « une affaire embrouillée sans commencement ni fin », autant d’automatismes beckettiens : « ainsi disparaissent, on ne sait où, chemin faisant, de larges intervalles de temps ». Père mort-mais-pas-complétement donc, nous en avons encore la confirmation dans la dernière nouvelle du recueil, La dernière fuite de mon père : « en ce temps-là, mon père était déjà définitivement mort. Il avait été mort plusieurs fois, mais jamais sans reste, toujours avec certaines réserves qui nous obligeaient à réviser le fait même de son décès », et on nage là d’ailleurs encore en plein Kafka, à vue de nez en tout cas, puisque le père se réincarne en écrevisse ou en scorpion, en sorte de crabe, qu’on observe de l’extérieur cela dit, sans être instruit de ce qu’il ressent, moins sujet qu’objet dégoutant ; on n’est justement pas dans la translucide énigme kafkaïenne qui, de l’intérieur, ramifie ses intraitables conséquences jusqu’à leur terme, non, car chez Schulz, on procède plutôt par petites touches parallèles, on progresse par impressions, traits d’union, soupirs et phrases inachevées, de même qu’on n’essaie plus d’élucider (« il était engagé déjà bien trop loin pour qu’on eût une chance de l’atteindre »), comme le fera Kafka dans la Lettre au père, ce complexe obsessionnel vis-à-vis du père, figure non moins omniprésente pourtant, mais comme absente à elle-même, ayant moins prise sur la subjectivité de l’auteur, honteuse et envahissante peut-être (il n’en finit pas de mourir, c’est bien la preuve qu’on ne s’en débarrasse pas à si bon compte), mais impuissant — trop dérisoirement pinailleur et théâtral — à exercer le genre de tyrannie qui aura inspiré à Kafka l’infini sentiment de culpabilité[1] dont celui-ci n’a trouvé à s’émanciper, à hauteur de ses modestes forces et son poignant génie, qu’en littérature. Le père, oscillant ici entre le sublime (quand, lors de ce qui ressemble à un bal des pompiers, « fulgurant de tout l’éclat de son armure, il exécuta en silence un magistral salut militaire, puis, les bras étendus, clair comme un météore, il bondit dans la nuit qui brillait de mille feux » : il se jette par la fenêtre pour atterrir sur la bâche tendue par les pompiers) et le pitoyable, et le plus souvent sur ce dernier versant du fil du rasoir, est traité sur un mode baroque fondant ensemble burlesque et pathétique, Schulz appelant un chat un chat, et une mouche une mouche, pour décrire, avec toute la sagacité de l’image requise mais aussi sa contrepartie d’humaine compassion, la colère à laquelle s’abandonne son père lorsqu’il surprend les commis qui, alanguis par la morte-saison (titre de la nouvelle) dans la boutique de draperies désertée par ses clients, se sont taillés des hamacs dans toute cette étoffe sans emploi qu’ils ont sous la main, et consacrent comme tout le monde les heures caniculaires à la sieste :
« Par coups violents, sa figure se décomposait en couches symétriques suivant les lignes de son épouvante : il muait tout entier, là, devant nos yeux, sous le poids d’un inconcevable désastre. Avant même que nous ayons pu comprendre ce qui lui arrivait, il se mit à vibrer et vrombir, puis s’envola sous nos regards, grosse mouche velue, monstrueuse dans son corset bleu acier, insecte qu’un vol dément lançait à tort et à travers contre toutes les parois de la boutique. Émus jusqu’au fond de l’âme, nous écoutions le lamento sans espoir, la plainte sourde mais éloquemment modulée qui, là-haut, sous les vieilles solives du plafond, parcourait le registre complet d’une souffrance insondable et sans remède. »
Chez Schulz le prisme du souvenir d’enfance revisité par l’artiste, l’immaturité chez Gombrowicz, l’inassouvissement chez Witkiewicz, tous trois représentants d’une certaine avant-garde polonaise, très locale, chacun dans son registre éminemment personnel (seul Gombrowicz, benjamin à l’abri de l’exil argentin, survivra à la Deuxième Guerre mondiale) : le monde est vu par eux d’en bas, qui n’en visent pas moins haut pour autant. Incomplètes et frustes certes l’enfance, la jeunesse, l’infériorité, mal dégrossies, mais combien imprévisibles et sans révérence aussi, sans le surmoi mutilant que s’inflige l’âme mûre, l’imagination en berne. Nulle psychanalyse ici pourtant, nul réductionnisme freudien au programme, ce n’est pas le propos de la vie selon Schulz (pas plus que sa relation avec son père ne saurait épuiser l’œuvre de Kafka) (interrogé, trois mois avant sa mort, par Dominique de Roux et Michel Polac au sujet de la psychanalyse, Gombrowicz répond pour sa part en substance que la science en général, c’est bien joli, mais ce n’est pas son affaire, semblant ce faisant prendre au sérieux la prétention de la discipline à la scientificité — statut que, à sa manière bien à lui, lui refusait justement Wittgenstein, jamais commenté, ni peut-être lu, à ma connaissance, par Gombrowicz qui était en revanche plus féru de philosophie continentale, et d’existentialisme bien sûr, mais attention, d’un existentialisme non sartrien : « Sartre, dans son dédain théorique pour la douleur déclare que, pour un homme qui choisit la douleur comme bien, la torture peut devenir un plaisir céleste. Cette affirmation me paraît fort douteuse et caractéristique de la bourgeoisie française qui, fort heureusement, a été préservée depuis assez longtemps de douleurs fortes. »[2]) ; et si, comme le croit Deleuze (je résume de mémoire cette idée que j’aime bien), l’homme ne délire pas seulement sur papa et maman, mais délire plutôt l’histoire et la géographie (délire tout transitif, donc), la société et l’univers entiers, alors c’est avec le ciel, et plus précisément le ciel météorologique, que Schulz semble quant à lui dialoguer, y scrutant le message des saisons : qu’annonce-t-il, ce ciel, que dit-il aux hommes, que dit-il des hommes qui, sous lui, à la merci de ses amples humeurs, foulent le sol de cet insignifiant recoin du monde ? « Insondable est l’horoscope du printemps », « La nuit de juillet ! Comment la décrire ? », « L’autre automne — ce n’est qu’un vaste théâtre ambulant, tout rutilant, ruisselant de songes poétiques et de mensonges, un bel oignon mordoré qui renouvelle le décor en s’exfoliant, se détachant pelure après pelure. Jamais, au grand jamais vous n’en atteindrez le fond ! » Et pourtant, comme s’il y emploie, Schulz, à sonder, décrire, atteindre le fond des augures du ciel en dépeignant son essor (il n’est pas pour rien dessinateur), comme il sait aussi rendre un honnête hommage aux toiles « dues à des peintres de troisième ou de quatrième rang » qu’arbore le petit musée kitsch de sa province, « ces impasses désolées de l’histoire de l’art connues des seuls spécialistes » : « une pénombre d’or brûlé tournait aux crépuscule sur ces toiles passées, usées par le temps et où, vétustes armadas oubliées, des flottes entières de caravelles et de galères croupissaient au fond de rades sans ressac et berçaient dans leur voile, que le vent gonflait toujours, la majesté des républiques mortes. » Et son père se demande même si, contaminant depuis son antre jusqu’au ciel, toute cette « perfection condamnée à elle-même » n’a pas sa part de responsabilité dans le flamboiement climatique de leur été indien, l’autre automne : « Comment s’étonner qu’une telle splendeur, à la fois impatiente et sans force, ait fini par s’incarner, se réfléchir dans notre ciel comme dans un miroir, par en embraser les horizons d’un véritable incendie » ?
Au sein d’une nation d’indépendance récente et incertaine, second couteau se niant tel sur la scène des affaires internationales, les trois mousquetaires de l’avant-garde ne craignent pas de fendre le carcan de la polonité, pour se mirer en l’infini, ou l’universel, pour de vrai cette fois, pas comme ceux qui, se mentant à eux-mêmes, singent la grandeur nationale. Au temps dont parlent d’ailleurs les nouvelles, avant la Grande Guerre, la Pologne n’existe tout simplement pas, écartelée par trois empires, la Galicie de Schulz se trouvant alors sous la férule austro-hongroise : « Le monde se limitait alors à François-Joseph Ier. […] Couché sur toute chose, François-Joseph Ier avait freiné le monde dans sa croissance. » La révélation du monde au-delà de ce père Fouettard des peuples, l’élargissement des perspectives lui viennent d’un album de timbres qui appartient à un camarade, et lui tient désormais lieu de toute géopolitique : « Je l’ouvris et les couleurs du monde jaillirent devant mes yeux, le vent des espaces immenses, le panorama des horizons tournoyants. Vous traversiez ces pages, tirant la traîne tissée de toutes les sphères et de tous les climats : Canada, Honduras, Nicaragua, Abracadabra, Hiporapundjab… » L’effloraison du printemps, le jeu de pistes dans l’album et les attitudes de Bianca, la petite fille qu’il croise chaque jour accompagnée de sa gouvernante, voilà les réseaux de signes entremêlés où le narrateur-enfant déchiffre l’écheveau de l’Histoire, déjouant en imagination, par l’enquête policière, un complot réel ou fantasmé. Qu’est-ce en effet à hauteur d’homme concret que l’Histoire en marche, ou la Politique au-dessus de sa tête, si ce n’est cette enquête perpétuelle à partir d’un faisceau hasardeux d’indices en miettes, ce tâtonnement divinatoire avec toujours un train de retard sur l’impénétrable statistique des événements ?

Last modified: 29 janvier 2023