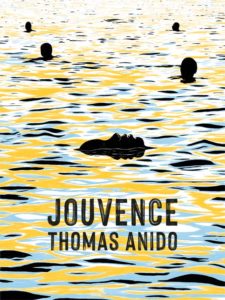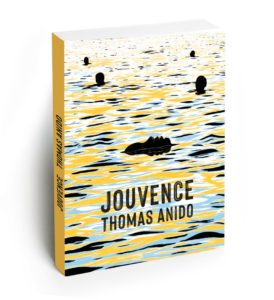Cela fait plus ou moins douze ans que j’écris, au sens d’écrire pour de vrai — une fois passé l’âge de la prose égotiste au style bouffi — l’esprit animé d’une conviction (d’aucuns diraient lubie) proprement littéraire, s’affirmant au gré des lectures, de l’expérience du travail et de la pratique de l’imagination. J’écris sous diverses formes : des nouvelles, des récits d’anecdotes ou de voyages, des journaux, des textes brefs de toutes sortes (contes, aphorismes, portraits etc.) et bien sûr, des romans. Jusqu’ici, trois romans.
Aujourd’hui, je ne publierais pas moi-même mon premier, sorte de dystopie pop et burlesque résolue dans une parodie de révolution. Un texte attachant mais trop bancal et mal abouti, péchant par naïveté : un tantinet gamin. Pourtant, à l’époque, ce n’est pas passé loin, auprès d’un éditeur dont la maison indépendante jouissait plutôt d’une position correcte « sur le marché » ; ça ne s’est finalement pas fait. Mon deuxième roman, cauchemar absurde et noir dans l’enfer des jeunes cadres dynamiques, culminant dans un week-end de team building nudiste, méritait sans doute que j’en allège le style ; néanmoins je crois que celui-ci, tentative singulière irréductible aux attendus d’un genre déjà balisé, aurait dû trouver preneur — ce qui ne suffit en soi à lui conférer aucune légitimité, malgré une croyance répandue parmi les écrivants vis-à-vis de leur propre production, comme on aura l’occasion d’y revenir dans une prochaine partie de ce manifeste. Personne n’en a voulu, de mon deuxième, et il m’a même semblé qu’il provoquait un rejet plus immédiat des éditeurs, signe au fond que j’étais sur la bonne voie — littérairement parlant. Je crois enfin que mon troisième roman, pensé, écrit, repensé, réécrit par vagues profondes, mis à l’épreuve par des lecteurs impitoyables (dont des éditeurs de métier), repensé, réécrit jusqu’à ce que son achèvement s’impose à moi comme une évidence absolument définitive, ne pouvait pas ne pas être publié. Il ne l’a pourtant pas été, et je n’en reviens toujours pas.
Pendant huit ans j’ai donc cherché un éditeur, successivement pour chacun de mes trois textes. J’ai « donné » comme on dit, j’ai fait le tour de la question, avec abnégation et assiduité, frappant à toutes les portes, enflammé par tous les faux espoirs, dépité à chaque coup dur, quoique de moins en moins atteint à mesure qu’avec l’âge, je me résignais. Des manuscrits, j’en ai envoyé des dizaines et des dizaines, plus de deux cents pour être exact, accompagnés de lettres d’introduction des plus neutres aux plus circonstanciées, et hormis la réponse positive dont je rêvais le soir en m’endormant, on m’a tout fait. Les non-réponses d’abord, le silence à jamais, mon manuscrit mis au pilon sans préavis, et les courriers-types bien sûr, courtois et impersonnels : « Merci d’avoir pensé à nous… Nous l’avons lu avec intérêt… Malgré toutes ses qualités… La rencontre n’a pas eu lieu… Nous publions peu… Nous vous souhaitons » etc. Il y a bien eu, comme évoqué, cet éditeur qui faillit publier mon premier roman, mais qui n’a jamais ne serait-ce que répondu à l’envoi des suivants. Il y a bien eu aussi celui, miracle, qui l’a accepté, mais c’était une de ces maisons obscures sans la moindre aura littéraire, une boutique opportuniste apparue (et disparue depuis) pour publier tout et n’importe quoi sous une maquette infâme, de la méthode de développement personnel aux recettes de cuisine ; on m’a convaincu alors de n’y pas aller, qu’à long terme cela me desservirait et peut-être aurais-je dû désobéir, puisque depuis, plus personne ne m’a dit oui. Je ne compte pas non plus ceux, suspects, qui vous répondent en moins de quinze jours avec un enthousiasme surfait et déploient des trésors de flatterie pour vous fourguer du compte d’auteur crapuleux à cinquante euros de votre poche l’exemplaire. Il y a eu les accrocs, avec un lunatique notamment, qui se croyait Diogène, génie cynique en son tonneau, mais n’était que roquet, éructant de la bouillie, qui s’est carrément mis à m’engueuler par e-mail après que je lui ai poliment soumis mon deuxième roman, et qui, pour me punir de m’être alors vertement défendu, m’a publiquement affiché sur son blog tout barbouillé de dadaïsme infantile. Il y a eu le Dilettante, connu comme le loup blanc parmi les candidats à l’édition, et dont les stagiaires péteux, qui ne doivent quitter la Sorbonne que pour Deauville, la Toscane ou New York, lecteurs invétérés d’Angot, armés de toute la morgue de la sottise, s’appliquent à vous assassiner en vous reprochant une phrase ou deux opportunément piochées parmi quatre cent mille signes. Il y a eu l’éditeur qui ne m’a informé que trois ans plus tard de son refus — TROIS ANS ! Pensait-il vraiment que je l’attendais encore, prostré dans le noir et retenant mon souffle, sans m’alimenter ? Ou bien sacrifiait-il enfin à la résolution annuellement différée de s’expurger d’une vielle liste de formalités ingrates en souffrance ? — non sans m’inscrire au passage, la bouche en cœur, à sa newsletter. Il y a eu celui qui avait eu l’air d’apprécier mon premier roman, qu’à cela ne tienne, je lui soumets le deuxième, et voilà qu’il m’abat d’un lapidaire « sachez monsieur que je ne vous publierai jamais » sans que je puisse comprendre quelle mouche l’a piqué. Il y a eu aussi ceux qui m’aimaient bien, car il y en avait, qui me gratifiaient d’un mot gentil à chaque essai, qui me donnaient quelques croquettes, une tape dans le dos ; courage, courage, une prochaine fois peut-être, mais non c’est non. Ou bien : c’est bien, bravo, mais voyez-vous c’est trop ceci c’est trop cela ou patati ou patata. On m’a tout fait… Mais le coup de grâce m’a été porté par ce jeune « Responsable commercial & Relations librairies » d’une maison indépendante. On m’a introduit auprès de lui pour mon troisième roman, il m’a lu et rencontré ; élogieux, il a comparé mon texte à Moravagine de Cendrars, au Lièvre de Vatanen d’Arto Paasilinna et au Quart de Nikos Kavvadias. Il m’a conseillé de retravailler, commentaires détaillés (et pertinents) à l’appui, et c’est ce que j’ai fait, d’arrache-pied, à plein temps pendant des mois, sans rechigner à me remettre en cause de fond en comble, jusqu’à ce qu’un jour j’achève la nouvelle version, alors je la lui remets en mains propres, et puis j’attends, je trépigne et je le relance, deux mois plus tard il se décide enfin, il m’appelle, il bafouille, pas eu le temps, il n’a pas lu, et me rapporte en tout et pour tout cet incroyable commentaire, dont je me souviendrai longtemps, de la part de ses patrons éditeurs : « Ils ont trouvé qu’il y a avait de bonnes phrases, mais parfois le rythme retombe ». Le coup de fil a duré moins de deux minutes.
Mon compte était bon ; j’en ai eu ma claque. Non, je n’allais pas remiser mon ambition de faire un livre, ni abdiquer devant le verdict des éditeurs, dont quatre-vingt-dix pour cent de la production est insignifiante, pas plus que je n’allais continuer à gratter des romans dans ma cave pour docilement les soumettre à la clique éditoriale, en attendant jusqu’à ce que mort s’ensuive une très hypothétique onction. Ce dernier livre, j’ai mûri longtemps la décision d’en réaliser l’édition par mes propres moyens — advienne que pourra.
Lire l’épisode suivant : Le marigot 2.0 de la post-littérature
Last modified: 9 mars 2021