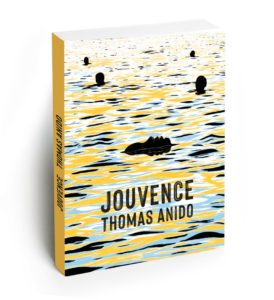Je ne suis certes pas le dernier à trouver les performances de Pogacar suspectes (ainsi que, en toute cohérence, celles de ses poursuivants directs, et j’ai déjà écrit à ce propos quand c’était son rival Vingegaard qui menait la danse), mais la rage qu’il suscite en ligne finit par me le rendre sympathique. Sa personne cristallise deux attitudes opposées, et caractéristiques du « supportariat », cet unisson sourd à toute nuance : il y a d’un côté ceux qui honnissent le Vainqueur (le Premier, le Dominant) par principe (sont-ils de gauche ?) et qui, scrutant la moindre de ses attitudes (coup de pédale, grimace — ou plutôt absence de grimace —, déclaration publique), l’accusent en conséquence de tous les vices : truqueur, tricheur, menteur. Serait-ce un autre Vainqueur qu’ils lui adresseraient strictement les mêmes reproches : il n’est que le véhicule interchangeable d’un archétype. De l’autre, il y a ceux qui adulent le Vainqueur (le Premier, le Dominant) par principe (sont-ils de droite ?), et voudraient en conséquence qu’il écrase chaque jour la course de son invincible supériorité, gagnant haut la main (ou, en l’occurrence, le mollet) chaque étape de montagne, matant impitoyablement, au même train qu’une grosse cylindrée, toute tentative d’échappée : la simple possibilité d’une limite à sa puissance (car, dans son cas, on ne peut même pas parler de signe de faiblesse, tant il en manifeste peu) leur fait l’effet d’un renoncement, d’une lâcheté, d’une trahison. Un comble : bien que je me sois promis de ne pas tomber dans l’un ou l’autre écueil, il peut m’arriver de me vautrer successivement dans l’un puis l’autre, suivant un mouvement de pendule schizophrénique, me surprenant d’abord à espérer malgré moi qu’il dynamite l’étape et cloue tout le monde sur place dans la montée, histoire d’avoir ma dose d’invraisemblable prouesse ; vouant ensuite aux gémonies, le cas échéant, la mafia sans scrupules qui nous confisque le Tour.
(En aparté, pour l’exemple, nommons un hater emblématique : Antoine Vayer, l’ancien entraîneur de l’équipe Festina dont j’évoquai dans mon texte de 2023 le travail salutaire de lanceur d’alerte, qui dénonce sans relâche l’hypocrisie du milieu, calculs de watts à l’appui. Mais il faut voir aussi comme cette croisade l’a aigri : le type vomit sa bile à longueur de jour sur les réseaux, agonissant d’injures toute personne liée de près ou de loin au Tour, journalistes, commentateurs, cyclistes ou simples amateurs, décrétant complice quiconque n’adhère pas inconditionnellement à sa ligne. Et j’ai tendance à croire que, quand bien même serait-il le seul au monde à détenir la vérité, cela ne suffirait pas à l’absoudre de tant d’ordures. Ne pourrait-on pas lui opposer que, du dopage, lui aussi a fait son fonds de commerce, à sa manière avantageuse de justicier incorruptible ?)
Pour revenir à mes moutons : quoi que fasse Pogacar, il est toujours trop surhumain, ou ne l’est jamais assez.
Humain pourtant il a semblé l’être, lorsqu’il a dit à la presse à l’issue de l’étape de Courchevel :
« C’est une question que je me pose : pourquoi suis-je encore là ? C’est tellement long trois semaines, on compte les kilomètres jusqu’à Paris. J’essaie de profiter de chaque jour même si c’est vraiment dur. J’attends avec impatience que tout se termine. »
Enfin quelque chose à se mettre sous la dent, pensai-je, en cette troisième semaine, passablement barbante — exception faite de l’ascension haletante du Ventoux, et je ne dis pas ça uniquement parce qu’un Français l’a remportée —, d’une édition 2025 qui avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue (sans doute la même remarque eût-elle été inconcevable de sa part l’an dernier, quand il remporta d’affilée les trois dernières étapes, comme quoi ça l’ennuie quand ça l’arrange, dirait une mauvaise langue). Pour ses détracteurs, cette petite phrase était bien la preuve de son arrogance, et pour ses adulateurs, celle de son ingratitude. Pourtant, ce champion sans failles, catalyseur d’invérifiables soupçons, ne nous dévoilait-il pas enfin une brèche ? Rien de bien nouveau, cela dit, à en croire les mieux informés des aficionados : j’ai ainsi appris qu’il se plaignait de l’organisation, des interminables transferts en car, des fastidieuses obligations protocolaires, et il paraîtrait même qu’il se coltine les grands tours à contrecœur, leur préférant les courses d’un jour, comme ces bouillonnantes classiques dans lesquelles il s’illustre chaque année au printemps. Des cancans et des on-dit, peut-être, mais nulle doute que dans son propos, un certain format était mis en cause, et pas n’importe lequel, celui d’une intouchable institution : le Tour de France.
(Au passage, on n’imagine pas le robocop-esque Lance Armstrong dire une chose pareille au temps de ses victoires usurpées. Pour en avoir le cœur net, j’ai demandé à ChatGPT, en lui soumettant la phrase de Pogacar, s’il avait « connaissance, dans l’histoire du Tour de France, d’un autre champion qui aurait aussi ouvertement exprimé sa lassitude ? » Il m’a servi des soi-disant citations de Bernard Hinault — « Je ne suis pas un surhomme. Moi aussi j’en ai marre de me lever tous les matins pour souffrir » —, de Chris Froome, de Cadel Evans, de Laurent Fignon et de Greg Lemond, mais quand je lui ai demandé ses sources, il a été incapable de m’en fournir. Sur ce coup-là, je le soupçonne d’hallucinations. En tout cas, aucune de ces citations, inventées ou pas, n’égalait celle de Pogacar en matière de « sincérité brute et presque existentielle », comme a cru bon de l’interpréter ChatGPT. N’ayant pas l’intention de poursuivre plus avant ces recherches, il faut donc croire que je n’aurai pas de réponse à ma question… En tout état de cause, peut-être me fourvoyé-je, mais je ne peux pas me résoudre à trouver Pogacar aussi détestable qu’un Armstrong : il faut lui reconnaître un certain panache et, contrairement au falot et calculateur Vingegaard, l’amour du risque, le culot de jouer souvent son va-tout, comme il l’a encore prouvé, tandis même que je mettais la dernière main à ces lignes, sur les pavés de Montmartre lors de l’étape finale).
Nul doute que la star multimillionnaire Pogacar se remettra de cette mélancolie passagère, et je ne serais pas encore prêt à parier, comme certains n’hésitent pas à le faire, qu’il snobera l’édition 2026. C’est que les enjeux qui le poussent dans le dos (tels un vent bienvenu dans un raidillon) sont trop forts, voilà le problème : celui d’un système, auquel le format démesuré de la course n’est pas étranger. Trop de pression, trop de pognon, trop de spectacle, trop de caravanes publicitaires, trop de kilomètres, trop de dénivelé, et tous ces fastidieux passages obligés, ces interminables étapes de plaine qui semblent exclusivement destinées à justifier l’existence des sprinteurs — ces inspecteurs des travaux finis —, et ces interminables cols cadenassés par l’enjeu du classement général. Trop de tout, trop de trop. Pour que le Tour retrouve son charme et son innocence, ne lui faudrait-il pas changer de formule ?
C’est, figurez-vous, ce dont je ne suis plus très sûr, après être tombé par hasard sur un documentaire de la chaîne LCP. On y suivait d’obscurs conseillers municipaux préparant durant des mois le passage du Tour 2024 dans un obscur village de la Creuse, Évaux-les-bains. L’envers du décor, quoi. La définition de l’itinéraire, les assemblées locales, les tractations avec ASO, les déboires logistiques, le critérium des enfants, les « ateliers fédérateurs » (soyons honnêtes, à l’EHPAD où on leur faisait dessiner des vélos, les vieux n’en avaient manifestement rien à faire du Tour de France…), la « pasta party pour faire monter la sauce », les objections des habitants dont les habitudes allaient être chamboulées durant vingt-quatre heures, les espoirs des commerçants décorant leur vitrine, l’attente générale des « retombées », la ferveur populaire du jour de fête… On pourrait trouver tout cela risible, et pourtant ça m’a paru touchant : l’engagement collectif au service d’un folklore immuable, aussi mercantile et kitsch apparaisse-t-il à l’œil désabusé. Les gens tiennent au Tour tel qu’il est.

Last modified: 28 juillet 2025