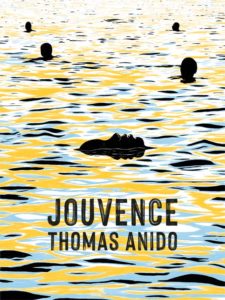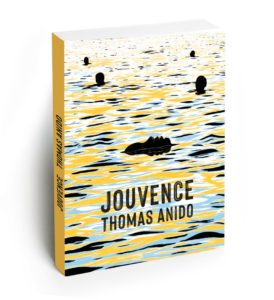Résumé de l’épisode précédent : où l’auteur n’est pas tendre avec les faux poètes du web.
On pourra reprocher à l’angélique corporation des poètes de produire n’importe comment du verbe surnuméraire, bon à rien, mais certes non pas d’être vénale, quoique on ne lui en voudrait pas d’être un peu moins prodigue de ses talents. Ce sera plutôt le cas, dans un style volontiers pragmatique, de tous les boutiquiers de l’autoédition qui se revendiquent parfois, pour faire sérieux, de la « littérature spéculative » qu’on appelle aussi, m’informe Wikipédia, la « paralittérature » — serait-elle à la littérature ce qu’est à la pharmacie la parapharmacie : un ersatz inoffensif ? — et qui comprendrait en fait les genres suivants, m’apprend-on encore : le roman d’aventure, le roman policier, le roman de gare, la science-fiction, le roman à l’eau de rose ou encore la littérature de colportage (le prospectus Picard bourrant nonchalamment ma boîte aux lettres relève-t-il officiellement de cette dernière catégorie ?). La littérature spéculative, en somme, c’est de la bonne vieille série B.

CONSEILS DE PRO (APERÇUS SUR UN BLOG)
Tous ceux-là écrivent du « roman », à la pelle, et revendiquent ouvertement le statut d’écrivain, dans un sens très professionnel, façon carte de visite. On n’imagine pas à quel point l’infinie travée du web regorge d’aspirants à la publication, gribouillant du polar, de la romance — connaissez-vous la « Chick lit » ? Et le « Young adult » ? —, de l’érotique ou du porno, de la « Bizarro fiction » (qui semble avoir l’honneur de désigner les nanars les plus grotesques), de la « Fantasy » bien-sûr, sorte d’excroissance dégénérative du genre fantastique, qui se décline elle-même en une myriade de sous-genres, héroïque, légendaire, féérique, mythique, médiéval, futuriste, spatial, animalier, extraterrestre, érotique encore, et j’en passe. Mentionnons enfin, en ce qu’elle incarne un certain paroxysme de la graphomanie, la pratique collective de la fan-fiction, triomphe conjoint du pire amateurisme et d’un fétichisme débridé, qui consiste pour les fans d’une franchise à succès — Harry Potter, Hunger Games, Games of Throne, Star Wars etc. — à en prolonger indéfiniment le récit par eux-mêmes, en brodant et tartinant à leur sauce des développements annexes, souvent notamment pour faire entrer de force dans l’œuvre originale ce qu’ils auraient aimé y trouver (leur nombril), ou même y corriger quelque élément qui leur aurait déplu.
Et tout ce petit monde, chacun dans son nième sous-genre (dernière porte à gauche), de s’autoéditer allègrement, sous tous les formats numériques possibles, de se distribuer sur toutes les plateformes imaginables, Amazon en tête forcément, et d’assurer en conséquence, à tours de bras, sa propre réclame parmi tous les réseaux possibles et imaginables ; et vogue la petite industrie, confrérie cheap d’amateurs kitsch s’imposant écrivains par la force du nombre, par la légitimité mutuelle qu’ils s’accordent entre eux quand ils échangent des recettes indigestes, des critiques complaisantes, et commentent en temps réel, à destination d’une audience acquise par intérêt réciproque aux bons procédés, leurs petits scribouillages, leurs rituels factices, leurs doutes nunuches, leurs efforts laborieux, leurs soi-disant trucs, le décompte des mots écrits dans la journée, quand ils mettent au referendum leur prochaine intrigue, s’interrogent à voix haute quant aux fêlures intimes de leurs personnages, demandent des suggestions pour un titre ou un prénom, partagent le synopsis d’une future nouvelle, quémandent des encouragements, sondent leur public et cherchent validation, toutes attitudes, afféteries, mimiques performatives consolidant à bon droit un statut usurpé, tels un gang d’illuminés au diapason s’autoproclamant lapins de garenne à la face du monde, et de glapir et grignoter la salade à même la terre dans la foulée, en se grattant l’oreille avec le pied, histoire d’enfoncer le clou. L’écrivain ne l’est plus par le texte, mais par la parlure.
Mon propos n’est pas ici de dénigrer les romans de genre. Chaque lecteur a ses fétiches, j’ai pour ma part une prédilection pour le polar et l’anticipation ; Conan Doyle, Maurice Leblanc (les aventures d’Arsène Lupin), Agatha Christie, Gaston Leroux (Le Mystère de la chambre jaune), Jules Verne, Georges Orwell, Ray Bradbury, Aldous Huxley, Philip K. Dick, Tolkien même dans une moindre mesure, et j’en oublie, ont marqué à divers degrés ma carrière de lecteur, sans même parler, si l’on remonte à ma prime jeunesse, des Contes du chat perché, du Club des Cinq ou de Jonathan Livingston le goéland.
En outre, la frontière est tout à fait poreuse entre ce patrimoine disparate, tous ces livres offrant au lecteur des gammes de plaisirs plus ou moins élaborés, et ce que j’appellerai ici littérature intégrale, intégrale en ce que l’acte d’écrire y est tout entier mu par un désir de littérature, et non pas tributaire des figures imposées de l’enquête policière, de la conjecture futuriste, du récit mythologique ou de l’édification morale. Littérature intégrale à laquelle j’inclurais par exemple l’œuvre de Boris Vian, au risque d’en faire bondir certains (j’ai lu un jour cette interview où Antoine Gallimard émettait le regret public d’avoir consacré une édition de la Pléiade à Vian, choix alors vigoureusement contesté par les vestales de la Haute Culture) ; littérature intégrale où l’on pourrait souhaiter maintenir Orwell pour ses intuitions visionnaires, le même Orwell que le rude Nabokov qualifia carrément d’« écrivassier »2, tandis que Julien Gracq m’agonirait sans doute d’en exclure Verne, en hommage duquel il avait choisi d’étudier la géographie, et il me faut admettre que tout cela est aussi question d’affect et de point de vue, mais pas seulement, car il y a bien un espace de dialogue, une cartographie dynamique mais circonscrite, un tronc commun indiscutable malgré ses ramifications incertaines, une généalogie en rhizomes à laquelle on pourra raccorder, de proche en proche et pour peu qu’on puisse élaborer des passerelles consistantes sous caution d’authentiques critères littéraires, ce qui nous chante. Littérature intégrale, donc, comme apanage de textes procédant d’une démarche exigeante, d’un affilage théorico-pratique de l’expression romanesque ou poétique, d’une inscription au sein de l’une et l’autre des multiples traditions entretissées a posteriori par la critique (non journalistique, j’entends) ; un conglomérat de singularités hétéroclites, véhiculant chacune suffisamment de richesse et de nouveauté pour irradier la discipline : la littérature intégrale, ce sont les grands crus de l’écrit — et ils sont assez nombreux pour qu’on n’ait pas à galvauder l’appellation.
Dumas, Wells et Stevenson sont-ils plutôt roman de genre ou genre du roman ? En tant que précurseurs, défricheurs de nouveaux territoires, sans doute sont-ils les deux à la fois. Des divergences tiraillent les spécialistes, des courants s’affrontent, chaque école a son idée des frontières classificatoires, fortement déterminées par le contexte dans lequel telle ou telle œuvre a éclos, son avant et son après ; c’est tout le jeu de la critique, hélas désormais si énergiquement attelée à satisfaire la boulimie du marché par l’extension indéfinie du domaine du commentaire, qu’elle en a cédé à l’instance jusqu’au-boutiste voulant qu’aucune catégorie ne vaille mieux que l’autre, que le douzième sous-sol de la Fantasy ne vaille pas moins que ma littérature intégrale, commandement qu’entérine d’ailleurs Wikipédia, dans un registre plus prescriptif que strictement encyclopédique, en cela parfaitement dévoué à la cause de l’air du temps, affirmant au paragraphe « Sens moderne » de l’entrée « Littérature » que « le champ de la « littérature » s’élargit au XXe siècle à toutes les productions écrites », rien que ça.

Le « sens moderne » du mot « Littérature » (source : Wikipédia)
Mon propos s’expose au mauvais procès d’élitisme, devenu ô combien infamant, dès lors qu’il s’agit d’accorder à certains textes une supériorité, oserais-je dire une noblesse (fussent-ils d’une forme absolument vulgaire), d’entériner leur appartenance à la lignée de la littérature intégrale parmi Kafka, Cervantès, Dostoïevski, Flaubert et consorts, et le sac de nœuds s’emmêle encore quand on y verse le contemporain, quand on sait tout ce qu’il se produit aujourd’hui, comme il s’en est produit hier et s’en produira demain, de mauvaise littérature se réclamant de la bonne, la médiocre majorité parasite qui joue sur l’inévitable presbytie frappant l’époque au moment de s’examiner elle-même, décuplée tant par la machinerie promotionnelle que par la prolifération des sous-genres en quête de prestige, mais qui d’ici deux générations aura totalement sombré dans l’oubli ; et pourtant, malgré tous ces écueils, il faut bien délimiter les choses d’une manière ou d’une autre, aussi élastique fût-elle, car l’on sent bien la différence fondamentale, de nature, entre Le Procès de Kafka et 1984, entre Sous le volcan de Malcolm Lowry et Le Chien des Baskerville de Conan Doyle, entre Virginia Woolf et Virginie Despentes, on sent bien qu’il y a tout un monde, un abîme, qui sépare les quarante pages chirurgicales du Bartleby de Melville des quatre mille, tassées en trois épais volumes, du Seigneur des Anneaux.
↑1Entre autres : Mario Vargas-Llosa, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Juan-Carlos Onetti, Carlos Fuentes, Adolfo Bioy Casares, Miguel Ángel Asturias, Ernesto Sábato, et bien sûr Jorge Luis Borges. Puis par extension : Italo Calvino, Mikhaïl Boulgakov, Salman Rushdie, Orhan Pamuk, etc.
↑2Brisure à senestre, « Introduction », traduction de Gérard-Henri Durand (collection Folio, page 13)
Lire l’épisode suivant : La sociologie contre la littérature
Last modified: 9 mars 2021