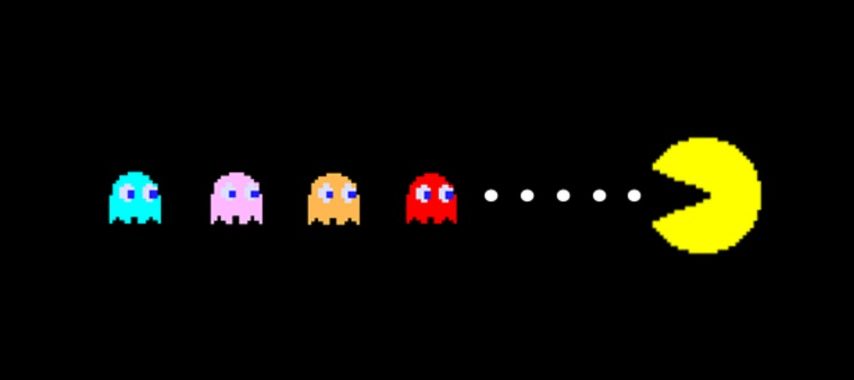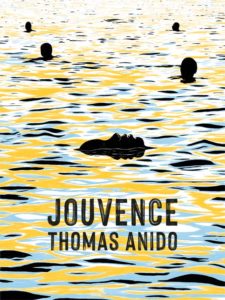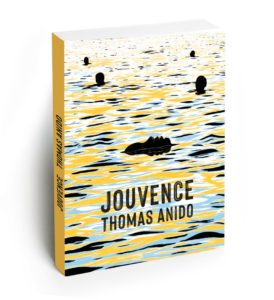Dans une sorte de mouvement contraposé, on trouvera les mêmes qui s’appliquent d’un côté à déprécier la valeur de toute tradition artistique, plaidant avec zèle de l’autre pour qu’on hisse au rang d’art : le jeu vidéo — on comprend d’ailleurs mal à quoi bon, puisqu’une fois celui-ci consacré, il faudrait implacablement le démolir ?

On pourra souscrire, pour s’en convaincre, à toute une batterie d’arguments livrés en kit, comme quoi d’abord le jeu vidéo englobe par inclusion logique les autres arts parce qu’il y faut de la musique, de la narration, de l’image, etc., selon cette confusion communément entretenue par l’ordre publicitaire — qui assimile volontiers fin et moyen — entre l’œuvre résultant d’une démarche singulière, et les compétences nécessaires pour la produire, comme l’écriture, la composition musicale ou la représentation graphique, des compétences qui, employées autrement, peuvent tout aussi bien contribuer à la conception de prospectus Picard, de livres de cuisine, de comptines pour enfant ou de cette marchandise hybride, culturo-ludique, qu’est le jeu vidéo. Ensuite, argument d’autant plus commode qu’il est vague et tarte-à-la-crème — une vraie passoire — les créateurs de jeu vidéo partageraient avec nous leur vision du monde, par la représentation d’univers réalistes ou imaginaires, par ailleurs tout à fait spectaculaires dans leurs formes actuelles les plus élaborées, il faut l’admettre, et c’est toujours d’une confusion entre fin et moyen qu’il s’agit, ou contenu et contenant, signifié et signifiant : si l’on doit se cantonner à cette acception large et sommaire de l’œuvre d’art (ou musicale, ou littéraire) comme « vision du monde », alors ce sera là son essence, sa fin dernière : donner à voir, à lire, à entendre un fragment de subjectivité humaine, quitte à ce que chaque destinataire parmi son public l’apprécie suivant son propre goût, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Mais dans le cas du jeu vidéo, la « vision du monde » devient l’alibi du jeu à l’usage du joueur, un décor qui prête une forme intelligible à l’hyper-objectivité informatique, au calcul des successions d’alternatives combinatoires, à l’écheveau probabiliste appelant tour à tour les actions réflexes et les stratégies réflexives les plus adaptées pour aboutir à la résolution du jeu. Dans le jeu vidéo, dont on ne niera pas ici la puissance d’évocation ni l’agrément ludique, la « vision du monde », c’est l’emballage qui habille les rouages, qui dissimule le principe mécanique du labyrinthe d’embranchements hypothétiques, c’est le capot couvrant le moteur ; tandis que dans l’œuvre littéraire, ce serait sa matière même, sa manière d’être, sa gratuité.
Et ainsi de suite, jusqu’à l’argument massue du progrès indispensable à l’art, qui implique d’en élargir indéfiniment la définition, sophisme imparable pour dissoudre le sens des mots, et nous faire oublier qu’un jeu vidéo est simplement un jeu, aussi complexe soit-il, on peut y jouer comme on joue au Monopoly, et il n’y a pas de mal à cela. Une sonate est une sonate, on l’écoute, on la joue mais on n’y joue pas. Un roman est un roman, on le lit mais on n’y trouve pas de boss final à tuer, ou de score à battre, et l’on n’y prend pas physiquement part à l’action (quand bien même mimerait-on dans sa chambre les escarmouches des mousquetaires à la lecture de Dumas). S’il doit exister un pendant papier au jeu vidéo, il est en toute rigueur paralittéraire, et sans doute désormais ringard : on appelle ça un « livre dont vous êtes le héros ».
Tout n’est pas littéraire, sans quoi la littérature n’est plus rien
Voici l’art réduit au jeu, et le jeu assimilé à l’art : tout jeu sur les mots suffirait à faire littérature. Il convient ici de rendre hommage à la prodigieuse inventivité dont font preuve les adeptes de Twitter dans la saillie sous contrainte, à base d’anecdotes et de calembours, de détournements visuels et de montages, pour ironiser sur le quotidien, brocarder nos travers humains, ridiculiser la propagande médiatique, dans un délire humoristique méta-viral confinant parfois au sublime (ainsi des « mèmes » les plus populaires). Moi-même, je m’adonne avec plaisir à la forme brève en jouant des codes que favorise l’outil dans ce qu’il a de meilleur : le partage universel du rire. Mais toutes ces chaînes croisées de commentaires vouées à l’oubli dans les tréfonds d’une ferme de serveurs, en elles-mêmes, n’acquièrent pas d’office consistance littéraire, n’atteignant pas à la cohérence d’un corpus universellement transmissible.
On voudrait pourtant nous faire croire que la moindre chiure en ligne est déjà littérature. Voyons François Bon, qui exploite en France le créneau de l’« uncreative writing » conceptualisé par l’écrivain américain (Wikipédia dit « poète », j’aurais tendance à dire « charlatan ») Kenneth Goldsmith, concept que Bon lui-même a traduit par l’« écriture sans écriture », en quoi il voit l’avenir : la littérature assistée par ordinateur. En théorie, c’est un gloubi-boulga indigeste et prétentieux, post-moderne chic, pseudo-deleuzien — « organiser la pensée, par plaques et nappes, par conjonctions et superpositions, et non plus enchaînement » — empruntant largement aux foutaises de l’art contemporain, proclamant l’avènement de « l’art du vrac » (vendu au poids ?), de la « poésie numérique », de « l’e-inclusion de l’ensemble de nos médias numériques », un art de l’intertextualité totale, du fragment spontané, de la performance éphémère, de l’imitation, de la transcription et même du plagiat, du jeu avec le code informatique, un art aussi du traitement de texte, paraît-il — « si on appelle une police Garamond il y a des visages derrière ça » (sic) écrit Bon quelque part, ce qui ne veut strictement rien dire.
En pratique, ça donne un impressionnant dispositif d’autopromotion tous azimuts, et François Bon qui arrose les réseaux (sur son site et ses comptes Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, et que sais-je encore) de contenus insignifiants — notes à la va-vite, photos en rafales et monologues face caméra — étant convenu que chacune des traces qu’il peut accrocher à la toile est déjà littérature en action, littérature du futur. Sous couvert d’humble contribution à la collectivité interactive, en pratique, ça donne cet écrivain qui chaque fois qu’il respire, éternue, hoquette, rote ou pète, prétend alors émettre un petit morceau d’éternité. Persuadé d’abolir les frontières de la littérature, moissonnant l’ivraie, il abolit en fait la littérature dans la graphomanie. C’est à l’ère du commentaire général un art officiel taillé sur mesure, dont grésillent sans répit les bavardages dérisoires, au bout desquels on trouve toujours quelque bouton d’accès à la boutique en ligne où l’on pourra s’arracher les livres, les podcasts, les vidéos et les ateliers d’écriture du Maître.
C’est qu’il croit religieusement au medium informatique comme garant en soi du statut littéraire du message. Rien n’interdit bien sûr au fragment en ligne d’être littérature, mais il me semble qu’on en jugera d’abord par le texte, la qualité et la cohérence des recueils, l’adéquation des formes d’expression au support, et il ne manque pas aujourd’hui d’écrivains qui mettent efficacement le web au service de la littérature, à divers degrés d’innovation formelle, sans pour autant céder à tous les colifichets du moment.
Qu’il me soit permis d’en citer quelques-uns (n’y voir aucune velléité d’embrigadement : views are my own, comme on dit) dont, à titre personnel, j’ai plaisir à lire le travail publié en ligne, et que j’indique ici sans distinction de statut — reconnus, confidentiels ou même anonymes :
- Le cristal introspectif du Journal sous la surface
- L’inventivité formelle du poète jardinier Lucien Suel
- Le burlesque déjanté de Vanhonfleur
- Les facéties quotidiennes d’Éric Chevillard
- La métaphysique corrosive de Jérôme Orsoni
- Les acrobaties oulipiennes d’Emmanuel Glais
- L’imaginaire fantaisiste du Recueil de faits curieux, improbables & inavérés
Lire l’épisode suivant : Littérature du futur, ou le règne de la quantité
Last modified: 9 mars 2021